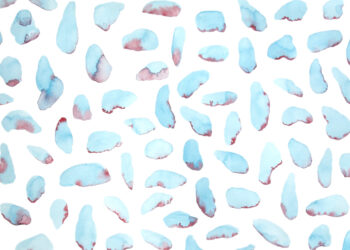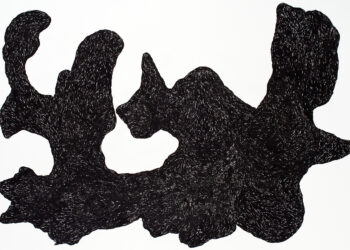Que devient la pudeur si la honte tend aujourd’hui à disparaître ? Pour y répondre, rappelons que la pudeur, comme le précise Jacques-Alain Miller dans sa « Note sur la honte », est « l’antonyme1 » de la honte. Cette pudeur-là milite en faveur du démenti fantasmatique du sujet, en protégeant le secret de sa jouissance.
Éric Laurent affirme que, le capitalisme étant désormais disjoint du puritanisme2, « il n’y a plus de honte3 » – du moins de honte à en mourir. Dans le Séminaire L’Envers de la psychanalyse, Lacan invite déjà les étudiants à faire ce constat, non sans un bémol : une tranche d’analyse ne tarderait pas à les faire buter sur « une honte de vivre gratinée ». Cette honte n’a cependant plus rien de mortelle…
Le remède à la honte
La pudeur comme remède à la honte est corrélée au fantasme, à la question phallique et aux plus-de-jouir qui agrémentent ou polluent la vie du sujet. Il s’agit alors de savoir si cette pudeur est différente selon la sexuation, puisque la partition de ces formules4 tient aux liens avec la fonction phallique. Ainsi Lacan note-t-il que l’organe mâle est toujours voilé, quelle que soit la civilisation observée. Un demi-siècle plus tard, cette pudeur tend à s’estomper : à l’heure de l’exhibition généralisée, la honte n’a plus cours. Mais au-delà de la « norme mâle5 » updated, voile-t-on encore quelque chose chez les femmes ? La pudeur féminine consiste-t-elle à couvrir ce qui est de toute façon non visible ? Les femmes sont-elles plus sujettes à la honte quand le voile se déchire ?
Dans cette perspective où plus rien n’est caché, l’évaporation contemporaine de la honte est inhérente à celle de la fonction paternelle. Qu’advient-il alors de la pudeur ? En guise de réponse, Lacan propose une autre forme : la « pudeur originelle6 » – ce tournant sémantique se situe dans le Séminaire « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse » où il apporte cette nouveauté.
La pudeur originelle
Il ne s’agit plus de la pudeur corrélée à la honte ou au dégoût7, comme évoquée dans le Séminaire Le Désir et son interprétation. Il ne s’agit pas davantage d’une réaction à la version sartrienne de la honte liée au regard inquisiteur, commentée dans le Séminaire I, puis nuancée dans le Séminaire XI comme défense contre la pulsion scopique8.
L’analysant en fin de cure peut nous en donner un aperçu. Au-delà du fantasme traversé, la pudeur originelle ne masque rien. En particulier, elle ne recouvre pas la jouissance exclue du symbolique, c’est-à-dire la jouissance féminine. C’est pourquoi Lacan note que la fin de l’expérience analytique féminise le parlêtre.
Comment circonscrire cette jouissance exclue du symbolique ? Comment s’en débrouiller ? Les restes symptomatiques, évidés de tout sens et la production du « Un » explicitée par J.-A. Miller dans son cours « L’Un-tout-seul », permettent de s’affranchir du démenti du non-rapport toujours corrélé au « refus de la fémininité » – un rejet déjà entrevu par Freud9.
C’est en ce point précis que la pudeur originelle trouve son importance éthique comme réponse au trou du sexuel dans la structure. Il s’agit de border un abîme, afin d’élaborer, si possible, un savoir nouveau à l’aplomb dudit bord. Cette pudeur spécifique n’est plus ni la gardienne du fantasme ni la prophylaxie de la honte. Elle répond au fait que « le réel soit concerné10 », précisément à cause de la forclusion du rapport. Finalement, si le Lacan du Séminaire « Les non-dupes errent » la décrit comme une « vertu11 », c’est parce qu’elle est l’antidote du solde cynique de l’analyse. Avec cette pudeur, il ne s’agit plus de se défendre contre l’obscénité, désormais frappée d’obsolescence. Toute honte bue, il s’agit juste de ne pas être « ignoble12 ».
Patrick Monribot
[1] Miller J.-A., « Note sur la honte », La Cause freudienne, n°54, juin 2003, p. 9.
[2] Cf. Laurent É., « La honte et la haine de soi », Élucidation, n°3, juin 2002.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 211.
[4] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 73.
[5] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 479.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XII, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », leçon du 19 mai 1965, inédit.
[7] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La Martinière/Le Champ freudien, 2013, p. 109.
[8] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les Écrits techniques de Freud, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 240 & 241 ; cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 166.
[9] Freud S., Résultats, idées, problèmes, t. II, Paris, PUF, 1985, p. 266.
[10] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 212.
[11] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 12 mars 1974, inédit.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 212.