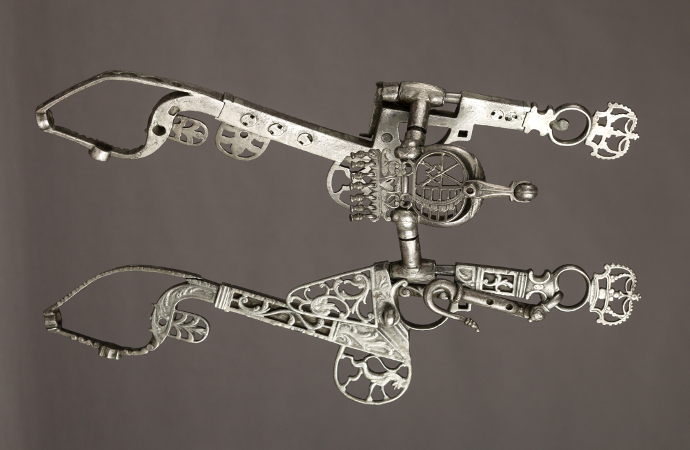L’élève qui demande « à quoi ça sert d’apprendre ? »(1) met en question l’usage du savoir transmis par l’Autre car il a l’illusion égocentrique qu’il s’en sortira tout seul. Le savoir est dans le réel avant d’être subjectivé, d’où la protestation de la position de l’enfant Ernesto, présenté par Marguerite Duras, qui avoue n’avoir pas l’idée « d’apprendre des choses qu’il ne sait pas ». Lui ce qu’il veut c’est apprendre ce qu’il sait déjà en rachâchant (2), répond-il à son maître qui échoue à le dresser selon son programme, tout en mâchant un chewing-gum, situant ainsi là où pour lui se situe sa jouissance : soit dans lalangue et dans sa bouche auto-érotique.
Ernesto met en tension les deux bouches du sujet, la bouche de la demande source de la curiosité soutenue d’un pourquoi ? et la bouche auto-érotique pulsionnelle qui se boucle sur elle-même (lalangue c’est du chewing-gum précise Lacan(3)).
Ainsi, il vient occuper la position du débile, ou du crétin selon Ernesto, qui cependant s’en défend, assis sur sa jouissance ; soit celui qui flotte entre deux discours en refusant de s’engager via la langue articulée à l’Autre, dans la voie de la transmission du savoir.
L’élève mettant en question le fait d’apprendre pense qu’il sait, qu’il a la vérité de son être, ce qui peut le conduire à l’errance dans la langue puis au-dehors. La vérité de son être, c’est ce qui surgit pour Ernesto qui, se sentant seul à l’école, prend peur et décide d’en partir pour marcher.
Une fois sorti de l’école, sa peur disparaît et il s’endort au pied d’un arbre. Et là, soudain, il comprend quelque chose qu’il a du mal à dire encore. « Je me suis retrouvé cloué : tout d’un coup j’ai eu devant moi la création de l’univers »(4) . Il précise bien que dans cet instant de révélation de la création, tout était là, le compte y était. « Pas un seul petit caillou qui manquait, pas un seul enfant qui manquait. Tout était exact. Sauf une chose. Une seule. » Ernesto précise que ce n’était pas quelque chose à voir, que c’était quelque chose de personnel. « C’était quelque chose qu’on savait. »
Quand il raconte cela plus tard à ses parents inquiets de son refus de retourner à l’école, il se trouve face à ce qu’il ne veut ou plutôt ne peut pas savoir. « On sait que c’est presque impossible à dire correctement, tout était là et c’était pas là. Du tout du tout. » Pressé par son père de le dire, Ernesto précise que ça s’explique pas, que c’est pas la peine. Le dire c’est pas la peine est repris par lui comme une litanie qui lui prend la tête et, du coup, c’est pas la peine non plus d’aller à l’école.
« Pour qui c’aurait été la peine, la vie ? L’école pour qui ? Pour quoi faire ? Alors c’est pas la peine pour le reste. »(5) Ernesto met ainsi en lien l’école et l’univers en expliquant à sa mère : « Tu n’as jamais cessé de comprendre, c’est toi la plus géniale de l’univers. »
Ainsi Ernesto a-t-il rencontré lors de son entrée à l’école ce quelque chose qu’il ne sait pas et qu’il ne veut pas apprendre. Ainsi la pantomime de son refus se soutient-elle de cette phrase : la mère met son enfant à l’école pour l’abandonner. La mère a quelque chose comme cela en elle, le désir d’abandonner son enfant. Et c’est cela, tout comme l’enfant d’ailleurs, qu’ils ne savent pas mais que l’enfant peut apprendre à l’école. Voilà l’insu dont se soutient Ernesto. La mère d’Ernesto sait par contre, qu’il est son seul enfant à s’intéresser à Dieu, même s’il n’a jamais prononcé son nom. Elle le sait car, pour Ernesto, Dieu, c’était le désespoir toujours présent dans son regard toujours déchiré, quelque fois vide. « Ce soir-là, ma mère avait su que le silence d’Ernesto, c’était à la fois Dieu et pas Dieu, la passion de vivre et celle de mourir. »
Plus tard, Ernesto expliquera à son instituteur, qui a tout tenté pour le faire revenir, qu’à l’école il a pris peur car il s’est trouvé devant la vérité : l’inexistence de Dieu. Voilà pourquoi pour lui, ça n’est pas la peine d’y aller pour apprendre ce qu’il ne sait pas, tout en précisant à l’instituteur que cela n’est pas la peine d’insister ni de vouloir le dresser car ce n’est pas la peine de souffrir. « On apprend quand on veut apprendre, Monsieur. »(6)
Son instituteur démontre un certain savoir-y-faire en acceptant, comme ses parents, les chewing-gums d’Ernesto. Ainsi propose-t-il au père ce qu’il faut faire soit : « Lui parler. Le raisonner. Revenir à une logique élémentaire. Parler. Tout est là. Parler dénouer la crise. La transférer. »
J’ai déjà parlé de la langue de l’authenti-cité dont l’adolescent use en ayant la certitude que c’est lui qui sait et que, du coup, il rejette la langue de l’Autre, celle qui véhicule un certain savoir, celui de ses parents, de l’école préférant prendre appui de son quartier, de sa bande de copains, ou celle comme Ernesto de lalangue.
Cette langue de l’Autre n’est pas de son temps à lui, n’est pas de son actualité, d’autant qu’elle inclut un manque, un vide qui fait trou insupportable pour lui : lui, il veut Tout tout de suite au nom de ses sensations immédiates, il se veut authentique, voire à ciel ouvert, sans le temps de la médiation. C’est plus une langue de présentation que de représentation dans le sens où il fait bloc avec elle, qu’Un tout seul.
Or, les choses existent en-dehors de lui, l’univers n’est pas organisé pour satisfaire les pulsions de l’enfant et l’adolescent à l’état brut (soit le côté chewing-gum du sujet). Ce qui nous réunit comme participant à la civilisation du monde échappe pour chacun à ses petites croyances personnelles.
La thèse de la psychanalyse est que, pour tout sujet, le langage est déjà là et préexiste au sujet, ce qui vient contrecarrer les théories de l’apprentissage qui ont l’illusion que le langage se remet à renaître chaque fois par un sujet donné. Le sujet dépend du langage de l’Autre, du langage qui le précède, du discours qui préexiste aussi au sujet dans le sens où ça parle de lui, bien avant qu’il soit là.
L’enfant reçoit la langue maternelle, il ne l’apprend pas et on peut voir comment, très tôt, il manipule des choses grammaticales. Il y donc dans le langage quelque chose de structuré et l’enfant élabore la grammaire à partir de ce qui fonctionne comme parole comme le précise Lacan.(7)
Il y a d’ailleurs une thèse forte chez Lacan : le savoir suppose, bien sûr, toujours une renonciation à la jouissance.(8) Cela veut dire que l’enfant doit renoncer à une certaine jouissance de la langue, de son rachâchant, s’il veut apprendre à parler comme tout le monde. L’école ne remplit sa mission que si elle ouvre, de façon exigeante, chaque élève à l’altérité et fait éclater son repli narcissique, sa posture de jouissance son rachâchant, ce qui, de façon paradoxale, l’enferme à son insu voire dans son insu, ce qui le rend d’ailleurs souvent insu-portable. Cette posture l’empêche de s’articuler à un autre savoir qui lui servirait à oublier ce qu’il est.
La psychanalyse nous apprend que le sujet essaye d’atteindre au bien-dire ce qu’on ne sait pas. Comment peut-on atteindre ce qu’on ne sait pas ? C’est un problème pour l’enseignant et pour l’analysant… Pour dire ce qu’on ne sait pas, il faut l’inventer : c’est la position du sujet dans le discours hystérique qui raconte des histoires.(9)
Interroger la disposition du sujet à apprendre nécessite que nous nous interrogions sur le désir et la façon de savoir-y-faire avec l’enfant ou l’adolescent comme nous l’ont démontré de la plus belle des façons Céline Souleille et Marianne Bourineau, lors de la soirée préparatoire des journées de l’ECF organisée par Pénélope Fay et l’ACF Aquitania dans un lieu magique : le Théâtre du Levain, à Bègles.
Il s’agissait donc de faire entendre au sujet que le fait d’apprendre sert avant tout à prendre la voie du désir, « d’ apprendre quand on a envie d’apprendre », comme le dit Ernesto, le savoir transmis par l’Autre comme objet.
Pour la psychanalyse, le désir de savoir n’a aucun rapport avec le savoir, le désir de savoir n’est pas ce qui conduit au savoir. Ce qui ouvre le chemin du savoir c’est l’amour dans la version du discours de l’hystérique, soit le sujet qui, assumant sa division, son manque, rencontre quelqu’un qui prend la place de produire en lui un mouvement d’investissement du sujet-supposé-savoir, qui vient occuper la place de soutenir un transfert d’amour du savoir, soit « un courant souterrain qui ne tarissait jamais » comme le note Freud dans son texte Psychologie du Lycéen.
Il faut faire entendre à ces sujets s’enfermant dans des positions solipsistes en refusant la langue articulée à l’Autre, combien, malgré la perte de jouissance qu’elle entraîne, la langue, dès l’instant, justement où elle s’articule à la langue de l’Autre, peut offrir au sujet, de façon paradoxale, la jouissance, voire l’usage d’un savoir inédit. Il y a ainsi une jouissance substitutive qui se trouve au niveau même du signifiant, car le signifiant est aussi au service de la jouissance.(10)
C’est là l’ouverture à La vraie vie à l’école comme lieu où l’on apprend à jouir d’un savoir nouveau dans un jeu de la vraie vie de l’esprit. Pour cela, celui qui est en position d’enseigner, ne doit rien céder sur son désir de transmettre les savoirs, jusqu’à inventer, souvent au cas par cas, la stratégie la plus efficace pour extraire le sujet de l’impasse de son solipsisme.
Le fil d’ariane qui soutient le savoir-y-faire de Céline Souleille et Marianne Bourineau, est bien la mise en usage de la langue comme moment d’ouverture de la parole vers l’expérience de l’Autre et sa différence mais aussi vers le manque de l’Autre dans le sens ou pas-tout peut se dire ou s’enseigner. Il y a un trou dans le savoir, et un savoir du non-savoir. L’école doit savoir qu’elle inclut, en elle, cette place du pas-tout. Elle ne doit pas revendiquer pour elle le côté impitoyable de la vie dit Freud. Pas tout peut s’enseigner ou se dire, précise fort justement Ernesto, ce qui évite des prises de position surmoïques. Cette expérience est bien celle de l’Autre porteur d’un manque, d’un trou, d’où l’attention particulière portée à l’invention et la singularité de chacun, mais aussi bien à son symptôme, son erreur ou échec.
Et si Rimbaud écrit Je est un Autre, il s’agit d’amener chacun à s’ouvrir à cet Autre étrange et étranger qui est au cœur de chaque être, le poussant à ouvrir la porte de sa langue, pour prendre, voire apprendre de la parole.
Le fil de la transmission nécessaire du savoir à l’autre, présenté lors de cette soirée de l’ACF-Aquitania s’orientait aussi de la place de l’enseignant faisant valoir la présence d’un autre que Montaigne, dans son texte, Sur l’éducation des enfants (11) nomma un guide pour acheminer chacun aux choses les meilleurs mais en ne perdant pas de vue le fait essentiel de ce que c’est qu’éduquer au XXI siècle. Le guide de Montaigne indique ici la place de ce savoir-y-faire avec ce chemin-là par lequel nos deux enseignantes de ce soir-là, témoignaient être elles-mêmes, déjà passées comme analysantes civilisées, rejoignant le savoir-y-faire de l’instituteur d’Ernesto.
1. Question que pose Farida à son professeur, dans le chapitre V de La vraie vie à l’école, Editions Michèle, 2013.
2 Duras M., Ah ! Ernesto, Editions Thierry Garnier, 2013.
3 Lacan J. , « Ouverture à la section clinique », Ornicar ? N°9, 1977.
4 Duras, M., La pluie d’été, Folio, p. 36.
5 Ibid., p. 38.
6 Ibid., p. 78.
7 Lacan J., in Scilicet 6/7 , p .47.
8 Miller J.-A., L’orientation lacanienne, « Du symptôme au fantasme et retour », cours du 3 février 1982.
9 Miller J.-A., L’orientation lacanienne, cours du 16 novembre 1983.
10Miller J.-A., L’orientation lacanienne, « Cause et consentement», cours du 23 mars 1988.
11. Montainge Sur l’éducation des enfants, Chapitre XXVI p 168.