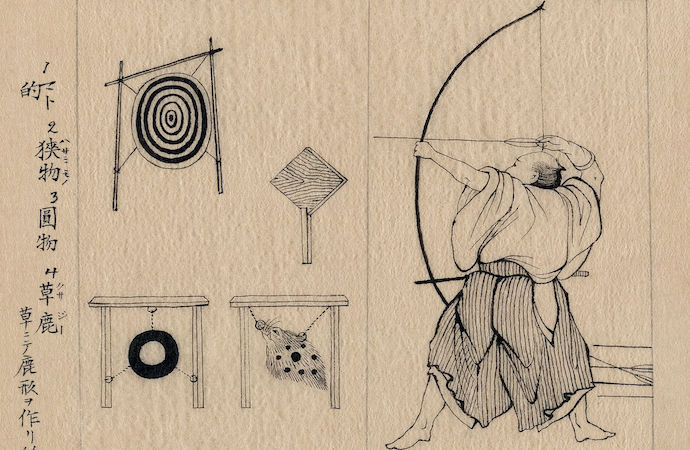Lacan n’a pas été très prolixe concernant l’AME (analyste membre de l’École) [1]. C’est ainsi que dans la version définitive de la « Proposition d’octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École » il se contente de dire ceci : « L’AME ou analyste membre de l’École, (est) constitué simplement par le fait que l’École le reconnaît comme psychanalyste ayant fait ses preuves. » [2]
C’est court on en conviendra. On peut en effet se demander ce que veut dire « un analyste qui a fait ses preuves » et pourtant même dans le contexte houleux de l’accueil qui a été fait à sa première proposition, on perçoit la dimension de pari et la confiance que Lacan met dans son école.
Je ne rappellerai pas ici l’historique de l’accueil négatif fait à la première version de la proposition. On en trouvera l’écho par exemple dans l’article écrit par Herbert Wachsberger qui figure sur le site de l’École de la Cause Freudienne sous le titre « Une École pour la passe 1967-1994 » [3] ainsi que dans le texte « Raison d’un échec » [4].
Pourtant le docteur Lacan supervise de près le règlement intérieur établi par l’École pour organiser le fonctionnement de la passe, et il vient présenter l’ensemble aux Assises de l’École freudienne de Paris (EFP) en 1969, dans une allocution publiée sous le titre « Adresse à l’École ».
Il y précise son point de vue sur les AME : « De toute façon il faudra bien que vous en passiez par l’attribution à certains de fonctions directives, pour obtenir une distribution prudente de votre responsabilité collective. C’est un usage qui peut se discuter en politique ; il est inévitable dans tout groupe qui fait état de sa spécialité au regard du corps social. À ce regard répond l’AME. Ces nécessités sont de base. Elles pèsent même in absentia pour employer un terme de Freud. Simplement, in absentia, elles se déchaînent dans tous les sens du mot. » [5] (Signalons à ce propos que cette allocution était prononcée dans la suite de Mai 68 et de ses slogans anti- autoritaires).
Distribution « prudente » donc de la responsabilité collective, et usage de l’AME pour faire face au corps social. Pour être l’intermédiaire entre la politique et l’École dont le but n’est pas le bien commun mais le discours psychanalytique, cause du désir dans une institution créée pour la psychanalyse. Ceci fait d’une École une institution qui obéit aux lois en vigueur dans un état de droit mais qui, en son sein est régie par une autre finalité.
La distribution prudente des responsabilités m’évoque un terme qui m’a frappé dans l’introduction à cette soirée proposée par Bernard Lecoeur. Il y parle de discernement, comme la qualité principale attendue par Lacan de l’AME. Ce terme issu de la direction spirituelle selon les principes d’Ignace de Loyola telle que la pratiquent les jésuites n’est pas sans évoquer ce jésuite rebelle que Lacan appréciait particulièrement, Baltasar Gracian, et son traité « El oraculo manual y arte de la prudencia ». Au-delà du bien commun, au-delà du raisonnement et spécialement du raisonnement scientifique, la décision prise avec discernement énonce clairement ce qu’il convient de faire pour rejoindre le but ultime qui serait la volonté de Dieu dans le discernement selon Ignace de Loyala, et pour les psychanalystes selon Lacan, pour ce qui serait la cause du désir.
Pourtant Lacan n’idéalise pas l’AME car : « L’analyste ne s’autorise que de lui-même, cela va de soi. Peu lui chaut d’une garantie que mon École lui donne sans doute sous le chiffre ironique de l’AME. Ce n’est pas avec cela qu’il opère. » Comme il l’indique dans la « note italienne », [6] écrite en 1973. Si le psychanalyste est « un saint » ainsi qu’il en fait mention dans Télévision, écrit la même année, c’est un saint qui « décharite » et dont le discernement se règle sur l’objet a, déchet, palea qu’il sait incarner à la fin des cures qu’il dirige, et non pas sur l’agalma portée plutôt par l’AE. Il est en effet attendu de l’AME qu’il ait fait la preuve « qu’à s’autoriser il n’y ait que de l’analyste » selon la formule de la Note italienne.
Ce discernement, attendu de l’AME dans les affaires de distribution des fonctions directives dans l’École et d’interface de l’École avec le monde ne le dispense pas d’être —et c’est bien souvent méconnu— au joint de la psychanalyse en extension et en intension : il a en effet le privilège de désigner la pièce la plus délicate du dispositif de la passe : les passeurs.
Il se trouve que j’ai été il y a longtemps nommé AME puis AE et que j’ai fonctionné avec le temps à toutes les places dans le dispositif. Il faut d’abord dire que le dispositif de la passe a changé considérablement depuis de début de l’ECF. Il n’a pas changé dans son principe mais beaucoup dans ses modalités et surtout il s’est tenu à la hauteur « de la subjectivité de son époque » comme Lacan le disait déjà dans « Champ et fonction de la parole » [7].
L’AME correspond dans la passe à la face de désêtre qu’elle comprend, alors que l’AE en représente la face agalmatique, la face de satisfaction de la fin. Le passeur se situe entre les deux. Il faut qu’il ne soit ni fasciné par l’idéal de la passe et en particulier non identifié au passant qu’il entend, mais il doit discerner chez ce passant une singularité qu’il peut accueillir et restituer à la commission comme la « fameuse plaque sensible » que Lacan lui impute d’être. En 1990 à Rennes Patricia Bosquin-Caroz témoignait de cela en disant que, nommée passeur elle était dans un état de « curiosité » à l’endroit de ce qui pouvait faire qu’un passant se présente à la passe. Il fut un temps où le passeur était passif, il notait ce que le passant lui disait sous la dictée et relisait devant un cartel quasi muet le fruit de sa récolte. Ce n’est plus le cas aujourd’hui depuis notamment la refonte du cartel en commission de la passe en 2015 on attend des passeurs qu’ils donnent plus d’eux-mêmes et de leur sensibilité dans la rencontre avec les passants. L’idéalisation de la passe qui a prévalu longtemps figeait les différents acteurs dans une angoisse de mauvais aloi. Jacques-Alain Miller a plusieurs fois indiqué que la passe n’était pas une cérémonie rituelle mais pas non plus une chambre d’enregistrement. Un dialogue entre le passant et le passeur est souvent de mise pour éclairer les points d’ombre.
Beaucoup d’AME ne désignent pas de passeurs. Cela a été un souci pour moi pendant la période où j’étais secrétaire de la passe de la commission A12-B12. Et j’y ai veillé de près .Il est important en effet d’avoir un nombre de passeurs suffisant pour ne pas emboliser la passe. Il m’est arrivé de téléphoner à des collègues pour leur rappeler cette part de leur fonction. Cependant un AME ne peut pas désigner un analysant sur commande. Là aussi le discernement s’impose : pas tout patient est susceptible de fonctionner comme passeur. Le moment de la désignation aura certainement des effets sur l’analyse. Que l’analyste décide d’en avertir l’analysant ou qu’il laisse à la commission le soin de le lui faire savoir, il y aura des effets sur la cure. Ces effets auront valeur d’interprétation. On ne peut jamais calculer la portée d’une interprétation mais on doit tout au moins tenter de viser juste. Je me suis aidé pour ma part de la « théorie des cycles » de Jacques-Alain Miller [8].
La fin d’un cycle produit en général un effet d’allégement et de satisfaction et si l’analysant désigné passeur est par ailleurs suffisamment engagé dans les affaires de l’École et curieux de la passe, la désignation produit une relance de la cure.
[1] Intervention lors de la Soirée de la garantie, « Le passeur, une question pour l’AME », organisée par la commission de la garantie de l’École de la Cause freudienne, 18 mars 2019.
[2] Lacan J., Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p.243.
[3] https://www.causefreudienne.net/une-ecole-pour-la-passe-1967-1994/
[4] Lacan J., Autres écrits, op. cit., p. 341.
[5] Lacan J., « Adresse à l’École », Autres écrits, op. cit., p. 294.
[6] Lacan J., « Autres écrits Note italienne », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p.307.
[7] Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.321.
[8] Miller J.-A., Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse. La conversation de Barcelone, Paris, Navarin, 2005.