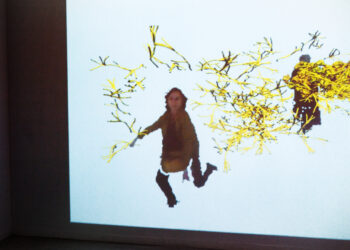À l’instar de philosophes, essayistes et sociologues, comme Eva Illouz1, les travaux et enquêtes sur la vie amoureuse de nos contemporains nourrissent un pessimisme croissant quant à l’avenir de l’amour au temps du capitalisme. L’observation de l’individualisme et sa parfaite adéquation au consumérisme constituerait selon eux les conditions d’un « egocène2 » propice à la fin de l’autre et donc de l’amour. Ce dont Vincent Coquebert donne une raison : l’utopie individuelle de l’épanouissement de soi nous a mené à une ère de repli constituée de « micromondes dépeuplés » créés sur mesure par le système marchand.
D’un point de vue économique l’amour est couteux, pense Alain Badiou : « Ne vient-il pas justement aliéner notre droit souverain à vivre uniquement pour nous-mêmes ?3 », soulignant la contradiction du sujet contemporain, dépendant de l’amour mais voué à sa satisfaction propre. « Or, au marché des satisfactions individuelles, la passion amoureuse est proprement hors de prix.4 »
Ailleurs, la menace d’extinction de l’amour se rapporte à la question de sa persistance. Pour Pascal Bruckner « Ce n’est pas seulement le caprice, l’égoïsme qui tuent nos liaisons, c’est la quête d’une passion permanente comme ciment du couple. […] Ou la ferveur ou la fuite, pas de demi-mesure5 ».
À ces plaintes vient s’ajouter la dénonciation des technologies qui ravalent l’amour au rang de produits dont le marché tire des bénéfices et, loin de soutenir le lien social, ségréguent et isolent.
Pour les psychanalystes, ce constat n’est pas une découverte. Nous avions observé lors de la préparation des 45e Journées de l’École de la Cause freudienne6 que la solitude fondamentale du parlêtre pousse, dans notre civilisation du primat de la jouissance, « à œuvrer pour se lier à l’Autre7 ». La quête du couple vient combler un défaut croissant de lien social secondaire à la disparition d’institutions comme la famille. Dès lors, que signifie l’egocène, sinon la manifestation de ce que Jacques-Alain Miller énonçait comme « la négation de l’inconscient par quoi le parlêtre se croit maître de son être8 » ?
Comme on le sait, Lacan s’est prononcé sur le sujet de l’amour et du capitalisme le 6 janvier 1972 : « Tout ordre, tout discours qui s’apparente du capitalisme laisse de côté ce que nous appellerons simplement les choses de l’amour9 ». Il n’en prophétise pas pour autant la fin de l’amour, mais le rejet de la castration, donc de l’Œdipe.
Cette impasse dans le lien à l’autre de l’amour n’est donc pas nouvelle, elle révèle qu’avec le déclin du Nom-du-Père, non seulement « les semblants vacillent, mais ils sont reconnus comme des semblants10 ». Et quand le semblant se dénude, le réel du non-rapport sexuel se dévoile, interprété comme imposture imputée à l’autre. Ce sont ces failles du parlêtre que le capitalisme et ses outils techniques exploitent, dit E. Illouz11.
Judith Duportail12 témoigne ainsi de sa longue et douloureuse quête d’un partenaire sur l’application TINDER. Jusqu’au jour où le garçon avec qui ça matche la quitte pour continuer sa recherche, « parce qu’il y a peut-être mieux en rayon », lui avoue-t-il. De princesse courtisée elle devient produit sur l’étagère, affublé d’une piètre valeur d’échange.
La débilité du parlêtre le rend perméable à la duperie du possible, dit J.-A. Miller, « la seule voie qui s’ouvre au-delà, c’est pour le parlêtre de se faire dupe d’un réel, c’est-à-dire de monter un discours où les semblants coincent un réel13 ».
Depuis, J. Duportail a abandonné TINDER et est mère d’un enfant né par PMA. Elle a, dit-elle, « fait le choix de faire famille hors du couple, et non seule ».
Xavier Gommichon
[1] Illouz E., La Fin de l’amour, Paris, Seuil, 2020.
[2] Coquebert V., Uniques au monde. De l’invention de soi à la disparition de l’autre, Paris, Arkhê, 2023.
[3] Badiou A., « L’amour, cette aventure obstinée », in Birnbaum J. (s /dir.), Amour toujours ? , Paris, Gallimard, 2013, p. 11.
[4] Ibid., p. 23.
[5] Bruckner P., « La sacralisation de l’amour », in Birnbaum J. (s /dir.), Amour toujours ? , Paris, Gallimard, 2013, p. 105.
[6] Les Journées avaient pour thème « Faire couple ».
[7] Alberti C., « Plus loin que l’amour », La Cause du désir, avril 2016, n°92, p. 23.
[8] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, mars 2014, n°88, p. 111.
[9] Lacan J., Je parle aux murs, Paris, Seuil, 2011, p. 96.
[10] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », op. cit., p. 113.
[11] Cf., Illouz E., « Rencontre avec E. Illouz, le capitalisme et La Fin de l’amour », La Cause du désir, juin 2020, n°105, p. 95-101.
[12] Duportail J., L’Amour sous algorithme, Paris, Éditions Goutte d’Or, 2019.
[13] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », op. cit., p. 113.