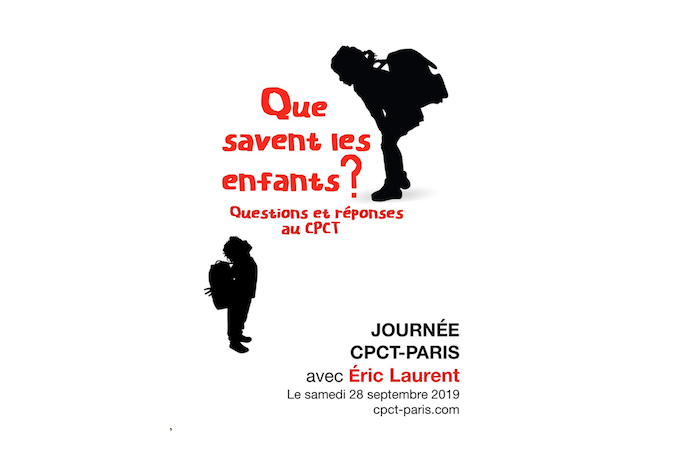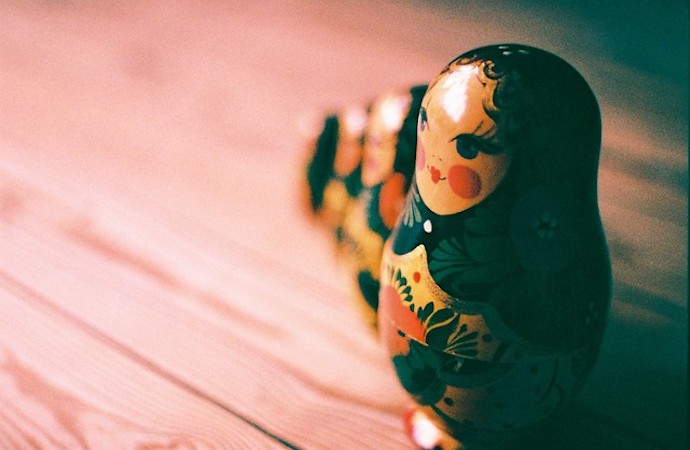CPCT-Paris : La prochaine journée du CPCT-Paris a pour titre : « Le savoir de l’enfant. Questions et réponses au CPCT ». Le sous-titre nous indique d’emblée qu’il ne s’agit pas du savoir – des multiples savoirs contemporains – sur l’enfant, mais du sien qui peut se découvrir dans l’expérience analytique. Comment entendez-vous, Hélène Bonnaud, cette indication : « Aucune maturation, aucun progrès ne définissent l’inconscient et c’est pourquoi dans les cures avec des enfants, les psychanalystes ont à répondre à la hauteur du sujet ? »[1]
Hélène Bonnaud : L’inconscient, en effet, n’a pas d’âge. Il ne connaît pas le temps, disait si justement Freud. Cela nous indique que l’inconscient n’est pas sensible à la maturation cognitive. Il ne mûrit pas, il ne mature pas. Même si nous considérons l’inconscient, avec Lacan, structuré comme un langage, nous corrélons l’inconscient d’un sujet à partir des paroles qui se sont dites au moment de sa naissance, et bien souvent, avant sa naissance. Celles-ci, en effet, impactent le sujet avant qu’il n’ait lui-même acquis la parole, ont des effets dans son corps. Cependant, le modèle de la cure d’adulte inventé par Freud, n’est pas superposable à l’enfant. Selon son âge, l’analyste va aménager l’espace de la rencontre. Il l’aménage pour faciliter la relation de l’enfant avec l’analyste, et surtout introduire la fonction du sujet supposé savoir dans le déroulement de la cure. Celui-ci peut prendre différentes modalités, car le petit enfant ne connaît qu’un seul sujet supposé savoir, c’est celui de ses parents et il s’agit, selon le symptôme dont ces derniers se plaignent à son encontre, d’accompagner l’enfant pour qu’il se détache de l’Autre du savoir auquel il est confronté, et qui parfois, l’empêche, lui, d’accéder à la vérité de son désir. Tant qu’il est assujetti au savoir de l’Autre, l’enfant ne s’autorise pas à se servir de son propre savoir. Il est figé sous les signifiants qui le désignent et le fixent à cette jouissance d’être l’objet du savoir de l’Autre. L’analyste se fait l’outil qui lui permettra de se déloger de sa fonction d’objet de l’Autre.
CPCT-Paris : Il n’y pas « une méthode spécifique adaptée aux enfants dans la psychanalyse [2] », ce qui décale de l’inflation des discours voués à s’occuper de l’enfant et de ses symptômes qui associent symbolique et imaginaire, comme nous le rappelle l’argument, vers un savoir « pas tout à fait dans le Réel, mais sur le chemin qui nous mène au Réel [3] ». Est-ce que vous nous l’illustreriez ?
Hélène Bonnaud : Il n’y a pas de méthode adaptée aux enfants mais il y a une psychanalyse d’enfants. Celle-ci intègre le fait que l’enfant, s’il est un sujet à part entière, est pris dans une dépendance réelle par rapport à ses parents. Ce sont eux qui demandent, s’inquiètent, souffrent ou s’interrogent sur leur enfant, − ou pas d’ailleurs, ce qui rend la chose plus périlleuse, quand c’est l’école qui pose le diagnostic. Du fait de sa dépendance, l’enfant est parlé et souvent trop vite interprété par l’Autre parental ou social. Son symptôme est annexé par le discours de l’Autre. Il y aura donc tout un travail préliminaire pour réinstaurer l’énigme que constitue le symptôme pour le sujet. Si ce travail n’a pas lieu, on ne fait que s’inscrire dans la série des personnes qui s’intéressent au symptôme de l’enfant comme une excroissance inutile qu’il faudrait éradiquer. C’est une des particularités de la psychanalyse d’enfant par rapport à celle de l’adulte. Ainsi, Jim, trois ans, consulte pour une agitation permanente. Son père n’est pas inquiet, car il dit avoir été « pareil à son âge ». En revanche, sa mère est épuisée et ne supporte pas son fils qui l’accapare continûment. On voit bien déjà que les deux parents ne vivent pas du tout l’agitation de leur fils de la même façon. Le père est pris dans l’image a-a’ de la relation à son fils. La mère se sent impuissante et rejette son enfant comme objet a, double du père. Elle décide de se séparer de ce dernier. L’enfant en devient encore plus insupportable avec elle. La séparation n’opère pas son effet d’apaisement parce que l’enfant et son symptôme ne font plus qu’un pour la mère et incarnent le réel d’une violence destructrice. Dans ce cas, comme dans chaque cas, l’analyste a à accuser réception de ce réel. C’est comme cela que j’entends la phrase « les psychanalystes ont à répondre à la hauteur du sujet ».
CPCT-Paris : Dans L’inconscient de l’enfant [4], après avoir évoqué, ce que la science cognitive qui en « sentinelle » exigerait d’un conforme, d’un pour tous, d’un normal, vous adressez à votre lecteur cette formule « complètement dépourvu de cette petite idée de l’enfance qui traverse la vie de chacun ». Mais qui est encore autre chose que la formule du poète romantique anglais Wordsworth « L’enfant est le père de l’homme » reprise par Freud et rangée aux antiquités par Lacan d’avant la psychanalyse… Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Hélène Bonnaud : Dans cette phrase, je réponds en effet à la platitude de l’approche comportementaliste qui n’a que le mot d’évaluation à la bouche. Cette maladie de l’évaluation touche davantage les enfants, en tant qu’ils sont l’objet de prédilection d’une science qui veut maîtriser le savoir et juguler les comportements pathogènes sans réfléchir à l’histoire de l’enfant ni à la jouissance qui l’agite. C’est un parti pris qui déshumanise et rejette l’enfant en tant qu’objet inéliminable. Quand on a été analysé, on sait à quel point l’enfance est primordiale du fait de l’impact des phrases prononcées par l’Autre, dès les premiers moments de la vie. Elle l’est, de structure. Freud l’a découvert et Lacan en a reformulé l’importance. Il ne s’agit pas d’analyser l’enfant qui est en nous mais de reconnaître les conséquences singulières de son histoire propre. La rencontre avec le désir de l’Autre fonde une marque indestructible et quand elle rate, − et elle est toujours plus ou moins ratée −, ça fait des vagues. Disons, pour rester dans la poétique de l’enfance, que les vagues de l’enfance roulent toujours sur des petites pierres qui forment un savoir insu. Et quand on bute sur elles dans son analyse, on rencontre leur existence et aussi la valeur traumatique qu’elles recèlent. Pour analyser un enfant, on n’ignore pas sa propre expérience de l’inconscient réel.
[1] Mahjoub L., « Que savent les enfants ? Questions et réponses au CPCT », argument de la journée d’étude du CPCT-Paris, 28 septembre 2019, http://cpct-paris.com/index.php/2019/06/15/sinscrire-a-la-journee-du-cpct-paris-avec-eric-laurent-28-septembre-2019/
[2] Ibid.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 11 juin 1974, inédit.
[4] Bonnaud H., L’inconscient de l’enfant. Du symptôme au désir de savoir, Paris, Navarin, 2013.