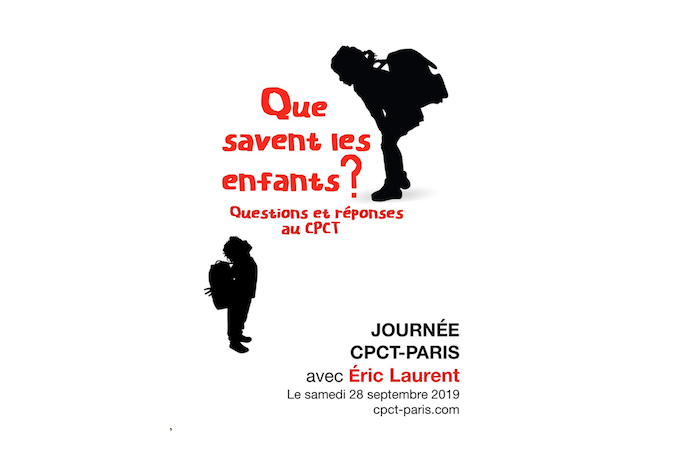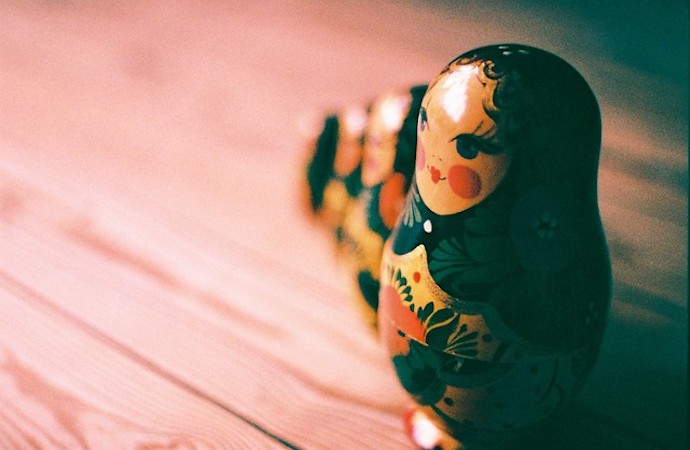CPCT-Paris : L’argument fait référence à l’interprétation qui peut virer à l’explication. Freud ne négligeait pas les explications données aux enfants, relatives à la sexualité ou à leur curiosité concernant la venue au monde des enfants. Il mettait d’ailleurs en lien l’inhibition de la pensée chez les adultes avec leur refus de donner des réponses aux enfants. Néanmoins, quelle distinction feriez-vous entre l’interprétation et l’explication ?
Daniel Roy : Dans sa « Conférence à Genève sur le symptôme [1] » Lacan indique combien le psychanalyste dépend pour son acte « des expliques [2] » de l’analysant. Nous sommes dans la même position avec un enfant par rapport à ses jeux, ses dessins, ses pantomimes : nous soulignons une articulation, qui insiste par sa présence, ou son absence ; nous « décompactons » un mot-valise ; nous relevons une équivoque. Mais, sur fond de ce motérialisme souligné par Lacan dans ce même texte, nous veillons à une différence qui reste fondamentale : soit nous intervenons dans le transfert depuis un point d’énigme, pour accompagner l’enfant vers ce qu’il peut prendre en compte de son désir ; soit nous prenons soin d’arrimer la signification là où elle fait des trous dans l’Autre du symbolique ou dans l’Autre du corps. L’explication, quant à elle, me semble répondre à un autre type d’exigence : celle qui consiste à parer aux carences ou aux violences de l’Autre de l’enfant, en fournissant à l’occasion les lois d’articulation du discours commun – lois de la parole et du langage qui autorisent l’existence d’un désir propre.
CPCT-Paris : L’argument fait aussi référence à l’impuissance de savoir des enfants, « impuissance de savoir ce que les adultes savaient ». Pourriez-vous nous éclairer sur cette « impuissance de savoir » ? Les théories sexuelles de l’enfant, qui sont une élucubration de savoir détachée de tout « savoir académique », se forgent-elles à partir de cette impuissance ?
Daniel Roy : Il y a un fait de structure qui caractérise l’enfance : les enfants reçoivent leur identification de genre – fille et garçon –, à partir d’un choix de jouissance qui ne s’opère, dans le meilleur des cas, qu’à la génération précédente – femme ou homme. Lacan a montré que cette identification sexuelle comporte en son cœur une impossibilité à savoir radicale. L’impuissance de savoir de l’enfance est la résonance subjective de ce point d’impossible inscrit dans la structure ; elle se prolonge volontiers aux autres « âges de la vie » (adolescence, adulte) et en cela il n’y a aucun développement qui vaille, uniquement des décisions, des prises de position. Ainsi les théories infantiles de la sexualité, comme Lacan les nomment, n’ont-elles rien d’infantiles et leur exploration par un enfant en analyse est une expérience formidable pour apprendre à ne pas s’effrayer du désir inconscient dans son lien à la jouissance. C’est la leçon que nous donne le petit Hans [3] et les enfants que nous accompagnons.
[1] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », La Cause du désir, n°95, avril 2017, p. 7-24.
[2] Ibid., p. 11.
[3] Freud S., « Analyse d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans (Le petit Hans) », Cinq Psychanalyses, Paris, PUF, 2003, p. 93-198.