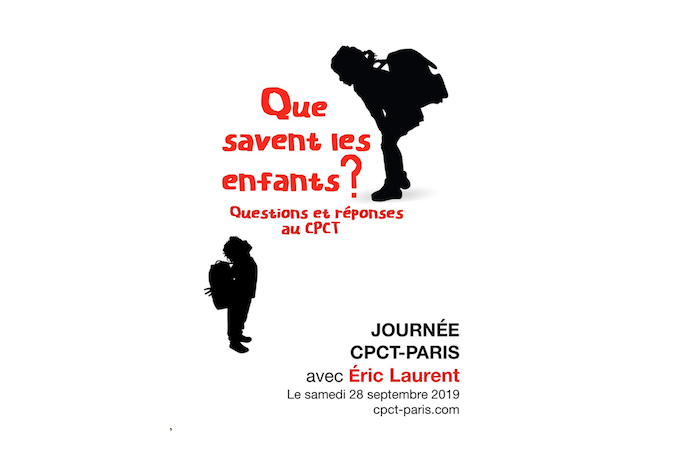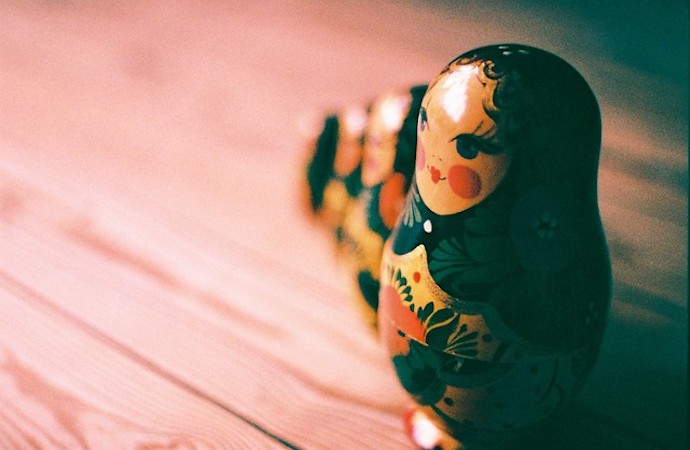CPCT-Paris : Dans l’argument de la journée du CPCT-Paris, Lilia Mahjoub reprend le terme « motérialisme », un néologisme de Lacan qu’il utilise « pour y situer la prise de l’inconscient, l’enracinement du symptôme, de ce qui cloche pour le sujet. » Comment s’illustre cette matérialité du signifiant chez l’enfant ?
Georges Haberberg : Lacan utilise ce néologisme de motérialité en subvertissant le concept de matérialisme historique, tel que Marx l’a fondé [1]. C’est donc une réponse théorique et pratique au contexte politique de 68, mais qui recentre aussi la politique de la psychanalyse, donc l’orientation de la cure. Elle réaffirme que le réalisme de la psychanalyse tient à la matérialité des effets du signifiant sur le corps, et précise que ce n’est repérable qu’à partir de certains mots qui, plus que d’autres, le troublent d’effets réels.
Chez l’enfant, c’est souvent repérable à l’état brut, quand un mot vient incarner un signifiant maître qui se retrouve directement dans la forme même du symptôme. Nous avons appris, avec Lacan, que cette prise symptomatique du mot sur le corps de l’enfant vaut aussi comme réponse du sujet. Pour l’enfant, le poids que fait peser, à son insu, le discours de l’Autre parental est donc essentiel, comme l’indique la formule de Lacan : « l’inconscient c’est le discours de l’Autre. » [2]
Il est même certains cas où c’est presque littéral. Je pense au cas d’une petite fille de six ans qui alarmait son enseignante par la posture qu’elle affichait, à savoir être absente des activités de la classe, toujours « ailleurs ». La mère, que j’ai d’abord reçue, s’inquiétait à priori de cette « absence » persistante qui empêche sa fille d’apprendre à lire et à écrire. Manifestement, cette petite fille était encombrée du poids de quelque chose, un savoir gênant, insu d’elle-même, qui retenait son attention « ailleurs ».
Une série d’entretiens avec la mère seule va révéler qu’à son insu, elle pose sur sa fille un regard rendu énigmatique par les circonstances de sa conception. En effet, l’enfant a été conçue lors d’une brève rencontre avec un homme étranger, de passage, un père géniteur qui s’est ensuite éclipsé pour regagner son pays, sur un autre continent. En articulant son récit, poussée par mes interventions, la mère s’aperçoit qu’elle ne cesse de scruter à travers sa fille cet « ailleurs », dans lequel le père a disparu. Elle réalise du même coup qu’elle ne peut s’empêcher d’adresser à son enfant l’énigme de sa conception. On peut alors dire que cette femme, devenue mère, fait porter sur sa fille l’énigme de l’incontournable question propre aux enfants, repérée par Freud : « D’où viennent les enfants ? [3] » Et sans doute au-delà, l’énigme de sa propre féminité.
Nos entretiens conduiront rapidement la mère à faire retour sur les circonstances de sa propre conception. Elle-même aussi enfant unique, elle fut conçue dans des conditions similaires à celles de sa fille, n’ayant jamais connu son père, un homme étranger, venu d’un autre pays. Cet instant de voir frappant, où la mère se saisit soudain elle-même comme étant retenue « ailleurs », provoque une rectification de son mode de présence qui la fait sortir du discours évasif qu’elle ne cessait, jusque-là, d’adresser à sa fille. Je recevrai quelque mois plus tard, pour un unique entretien de présentation, une petite fille bien présente, largement allégée du poids de cet « ailleurs. » La mère, entre temps, avait donc su rectifier son discours, soulageant sa fille du poids de l’énigme de sa propre conception qui la lestait elle-même.
CPCT-Paris : De quel savoir peut témoigner un sujet dit infans, quand il n’a pas, à sa disposition, tous les mots pour dire ?
Georges Haberberg : Lacan, dans sa « Conférence de Genève sur le symptôme [4] » fait cette remarque : « Ce que Freud a apporté, dit-il, c’est ceci, qu’il n’y a pas besoin de savoir qu’on sait pour jouir d’un savoir. » On peut entendre dans cette indication que si le sujet n’a pas à sa disposition les mots, il a pour lui le symptôme.
Pour cette petite fille, les mots manquaient bien sûr, en écho à l’absence de ceux qui manquaient à la mère. Elle « savait » quelque chose qui se manifestait, sans qu’elle le sache, à travers son symptôme, « être ailleurs », qui traduisait l’opacité d’un message adressé par erreur au mauvais destinataire, et que l’enfant retournait ainsi à l’envoyeur. Dans ce cas, on saisit bien pourquoi le poids du symptôme a pu être levé par le changement de position de la mère.
[1] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », La Cause du désir, n°95, avril 2017.
[2] Lacan J., « Le séminaire sur “La Lettre volée” », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 16.
[3] Freud S., « Les théories sexuelles infantiles », La Vie sexuelle, Paris, PUF, 1969.
[4]Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », op. cit.