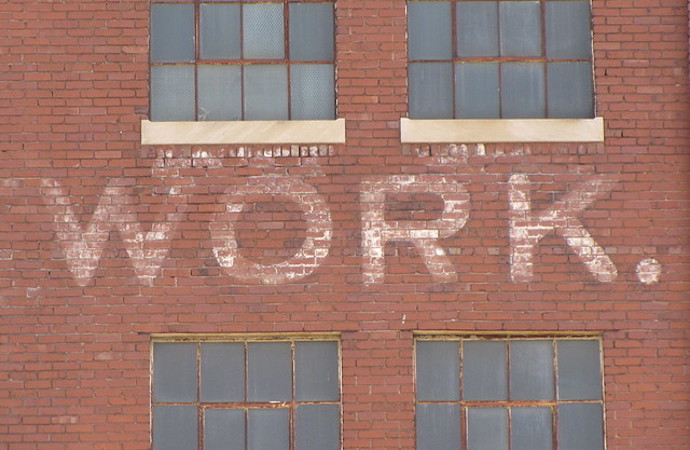Avant de commencer, je souhaiterais vous remercier et tout particulièrement Carolina Koretzky de m’avoir invité à participer à cette après-midi de résistance intellectuelle [1].
Je pense que nous tous, ici, sommes d’accord sur la nature de l’ennemi contre lequel nous luttons, bien que nous ne lui donnions pas tous le même nom. Qu’on l’appelle hyper-modernité ou post-modernité, ultra-libéralisme ou néo-libéralisme, nous constatons ses effets dans nos chairs, dans nos métiers, dans notre rapport au temps, etc.
Ainsi, je souhaiterais vous exposer les grandes lignes de la recherche que je mène actuellement, et qui donnera lieu à une publication cet automne, pour mettre des mots sur ces effets, sur ce nouveau « malaise dans la culture », et tenter d’en mieux comprendre les causes et de proposer quelques solutions. Pour cela, la méthode que j’adopte est de ne pas partir du général mais plutôt du très particulier, pour ne pas dire du personnel.
Nous avons rappelé que le groupe d’étude chargé par le Ministère de l’Éducation nationale de concevoir les nouveaux programmes de philosophie a voulu supprimer les questions de la subjectivité, du bonheur et du travail. Aux dernières nouvelles, la notion du travail sera rétablie en morale et politique, sous la forme du couple : « la société et le travail ». Tant mieux, mais cela ne répond pas à la question fondamentale. S’ils voulaient la supprimer, c’était au nom d’une exigence, au demeurant parfaitement légitime, d’allégement du programme. Autrement dit, ces universitaires très compétents ont considéré que la notion « le travail » était superflue, mais pas « la technique ». D’où la question : comment est-ce possible ?
Le travail, en effet, c’est ce à quoi nous passons le plus de temps, c’est ce qui nous permet d’assurer notre subsistance, de nous intégrer socialement, de sublimer nos pulsions, de donner un sens à notre existence. Toute la pression qu’on fait subir aux élèves avec le Bac ou Parcoursup, c’est au nom du travail vers lequel ils finiront par s’orienter. C’est, enfin, une question absolument classique de l’histoire de la philosophie. Je repose donc la question : comment est-il possible que des professeurs chevronnés et respectés aient pu considérer que le problème du travail pouvait être passé sous silence ?
À cette question vient s’en ajouter une autre, plus personnelle, qui est à l’origine de ma recherche. Je rencontre énormément de gens que leur travail rend malheureux. Et je sais, pour connaître beaucoup de psychanalystes, que vous faites ce même constat dans vos cabinets. Le cas des suicides chez France Télécom ou dans la police est bien sûr le plus visible, mais il y a aussi un indice qui ne trompe pas : les magazines comme Challenges ou Management, qui consacrent des dossiers tout le temps au bien-être au travail. Le marché s’est emparé de ce problème avec un incroyable cynisme, mais je ne veux pas m’attarder là-dessus. Ce qui m’importe, c’est de répondre à cette question : pourquoi est-il évident pour moi et pour beaucoup de gens de ma génération, sans même parler de la génération suivante, que le travail n’est pas un lieu d’émancipation alors que ça l’était pour les générations antérieures ?
Si je suis ces deux questions, j’aboutis au constat d’un paradoxe : aujourd’hui, nous travaillons tout le temps et en même temps nous ne travaillons plus, selon le sens que l’on donne au terme « travail ». En effet, par travail on peut entendre d’un côté les activités nécessaires à notre survie : nous produisons pour consommer, ce qui nous permet de reconstituer notre force de travail pour recommencer à produire. C’est le travail-châtiment divin dans la Genèse, la tâche de l’animal ou de l’esclave dans l’Antiquité et j’en passe. D’un autre côté, le travail est aussi l’ensemble des processus par lesquels l’homme transforme la nature et extériorise la conscience de soi. On admet volontiers que la scholè grecque ou l’otium latin, c’est-à-dire le loisir, soient aussi une forme de travail. Enfin, de nombreux penseurs comme Marx, Freud ou Arendt admettent la possibilité d’une synthèse entre les deux, que le travail a beau être physiquement pénible, il permet de se discipliner, de se dépasser, et puis, plus prosaïquement, de se libérer de la tutelle pour devenir autonome. Je vous renvoie, par exemple, au film grec Her Job de Nikos Labôt, sorti le mois dernier, dans lequel Panayiota, l’héroïne, en trouvant un job de femme de ménage dans un centre commercial, peut sortir de chez elle, de son rôle de mère au foyer, prend confiance en elle, se libère progressivement de son mari, etc.
L’analyse que je propose dans mon livre est que la première forme du travail a envahi la deuxième : tout notre temps, y compris notre temps libre, est désormais formalisé comme un processus de production-consommation. En d’autres termes, tout ce qui ne produit pas directement de la valeur marchande, ou qui ne permet pas d’augmenter à terme notre productivité, est considéré comme du temps perdu et donc n’est pas seulement condamné moralement ou socialement, mais nié, rendu impossible. Nous sommes tout le temps occupé, il est devenu quasiment impossible de s’ennuyer, de contempler, de lézarder. Nous sommes toujours en train de faire quelque chose.
Quand je regarde mes élèves, par exemple, mais aussi de nombreux adultes, je vois des gens qui dès qu’ils ont un instant d’inactivité, par exemple une pause de cinq minutes entre deux heures de cours, sortent leur téléphone et font quelque chose : envoyer un message, prendre une photo, jouer à un petit jeu débile. Ce faisant, ils créent de la valeur, à cause de la publicité ou de l’achat des data, ou alors ils se « vident la tête », ce qui est devenu la condition sine qua non pour pouvoir recommencer à produire.
Ainsi, l’important est de faire quelque chose, n’importe quoi, tant que c’est rentable, que ça produit de la croissance, même si c’est nuisible, immoral ou crétin. Ainsi, au lieu de ne rien faire, nous faisons rien. Nous usons ainsi non seulement les ressources naturelles, parce que jouer sur son smartphone nécessite de l’électricité, des batteries au lithium et j’en passe, mais aussi nos propres forces. C’est pourquoi je dis que nous vivons dans une société de consummation, qui considère comme normal et même qui valorise le fait de détruire la vie c’est-à-dire non seulement les êtres vivants, les êtres humains dans leur chair, mais aussi leur potentiel de créativité, leur intelligence.
C’est cet « esprit du temps » qui, d’après moi, explique aussi bien la volonté de faire disparaître le travail au profit de la technique, que l’omniprésence des neurosciences dans le discours politique. D’abord parce que le travail a été tellement déshumanisé, dévitalisé et formalisé par la technique que tout se passe comme si comprendre le travail ne nécessitait plus que de comprendre la technique. L’agriculture intensive n’a plus affaire à de la matière vivante, qui a son rythme propre, qui dépend des saisons ou de la qualité du sol. Dans les hôpitaux ou les EHPAD, le temps de toilettes ou de soin est calibré à la minute près, qu’importe la personne qu’on a face à soi. Les enseignants sont conduits à évaluer de plus en plus les compétences des élèves, non seulement les compétences scolaires, mais aussi les compétences psycho-sociales. Pour le dire très vite : le travail n’est plus un travail vivant, c’est-à-dire qui suppose que celui qui transforme une matière est en même temps transformé par elle, comme c’est le cas, par exemple, avec le transfert.
La société de consummation en séparant l’homme de la nature et de son propre corps le plonge dans un monde entièrement technicisé, dans lequel n’existe que ce qui est mesurable, quantifiable, ne serait-ce que pour pouvoir lui attribuer une valeur marchande. Or vous ne pouvez pas mesurer l’émancipation. Vous ne pouvez pas mesurer la joie. Un algorithme ne peut vous dire que ce qu’il y a de plus efficace pour réaliser une tâche, pas ce qu’il y a de plus agréable ou de réconfortant, ou de bouleversant.
Ainsi, est-ce que les neurosciences ont des effets discursifs ? Sans doute, mais je dirais qu’elles sont d’abord elles-mêmes un effet discursif. Je crois qu’elles ne sont pas dangereuses en tant que sciences, car elles ont des choses à nous apprendre sur l’être humain, et que les rejeter pour elles-mêmes serait aussi absurde que rejeter la génétique à cause de l’eugénisme ou la physique nucléaire à cause de la bombe atomique. Ce qu’il faut comprendre, c’est pourquoi les neurosciences sont encouragées par le pouvoir économique et politique. Ce n’est pas seulement pour leurs retombées économiques directes : faut-il rappeler le cas d’Edward Bernays, neveu de Freud, qui utilisa ses découvertes dans les relations publiques et la publicité ? La psychanalyse pourrait être rentable et donc financée. Mais selon moi, c’est plutôt un problème de langage : la psychanalyse, comme la philosophie d’ailleurs, parle une langue que l’idéologie actuelle ne peut pas comprendre parce qu’elle ne rentre pas dans les cases du techno-formalisme. Nous disons, nous, que ce qu’il y a d’humain en l’homme, sa liberté, sa créativité, ses émotions, sa culture, ne peut être traduit que par des mots et non par des chiffres. Que la qualité d’être ne peut être quantifiée. Qu’un enfant ne se réduit pas à une somme de compétences. Que la valeur d’une œuvre n’est pas fonction du nombre de « vues » sur les réseaux. Que le « travail bien fait » ce n’est pas le plus productif ou le plus rentable. Que l’intelligence ne peut être et ne sera jamais artificielle. Bref, il est urgent de ré-apprendre à travailler, c’est à dire de nous remettre en contact avec le vivant en nous et hors de nous, et par conséquent, aussi, à ré-apprendre à ne rien faire.
[1] Thomas Schauder est écrivain et professeur de philosophie. Son site : https://thomasschauder.fr/
Texte issu d’une intervention à l’après-midi préparatoire au Congrès Pipol 9, « Irréductibilité de l’inconscient, une suppression manquée », organisée le 25 Mai 2019 par l’ECF et la direction du Congrès Pipol 9.
( Titre de la rédaction )