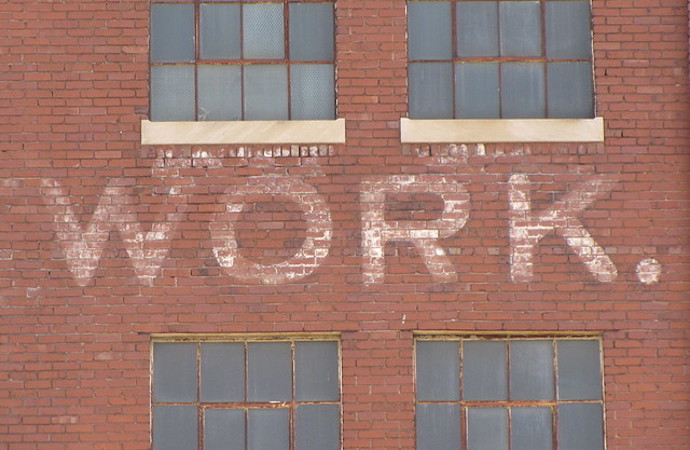Une tendance : alliance entre science et politique
La volonté de supprimer les concepts de travail et d’inconscient des programmes de Terminale a été probablement contrée cette fois-ci, bien que nous ne sommes pas à la fin de la procédure. * Selon les informations, assez fiables, que nous avons reçu, ces concepts ont été remis dans les programmes recommandés au ministre de l’éducation par le Groupe d’élaboration des projets des programmes, un groupe d’experts composé de quatre cents personnes, organisés en quarante petits groupes. Sans doute ce recul des experts est dû à la mobilisation des psys et des enseignants inquiets de cette démarche. On soupçonne même que cette information concernant la suppression possible de ces concepts majeurs de Marx et de Freud ait fuité pour prendre la température du terrain avant de déposer cette proposition. Une sorte de papier tournesol trempé dans la culture afin de savoir si ça passerait auprès de l’opinion publique ou pas. Puisque ce n’est pas passé, le projet a été lui-même supprimé. Pour le moment.
Mais au-delà de ces manigances, il y a là une tendance qui dépasse la France. En Belgique on parlait récemment de la disparition de la géographie et de l’Histoire comme cours spécifiques dans les écoles dans le cadre d’un « pacte d’excellence ». Connaître l’Histoire ne sert à rien. Ce qui est important c’est l’homme et son cerveau, ici et maintenant. Tout ce qui concerne son histoire, ses origines, n’a aucune importance. Au Brésil, Bolsonaro veut couper les finances aux facultés de philosophie et sociologie car ces études ne sont d’aucune rentabilité pour le contribuable. Mais ce qui est particulier et qu’on repère derrière ces projets c’est un discours spécifique qui, sous couvert d’une science, porte une idéologie. Celui-ci, soutenu en France par la personne de Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste et neuroscientifique pur et dur, qui est aujourd’hui président du conseil scientifique de l’Éducation nationale, chargé d’éclairer les décisions du ministre. C’est lui donc qui oriente aujourd’hui les programmes de l’Éducation nationale. Cette alliance entre le politique et la science, qui n’est pas la première dans l’histoire, est troublante.
« Sans l’inconscient » versus « l’inconscient c’est la politique »
Au-delà des émois que l’idée de supprimer l’inconscient produit chez nous, il faudrait qu’on puisse saisir les arcanes de ce mouvement de civilisation. Force est de constater que les neurosciences sont devenues, ces quinze dernières années, une des modalités de l’Autre qui déterminent actuellement le mode de vie occidental. Au fond, on peut mettre en tension le projet qui voulait dire « l’inconscient n’existe pas » (au programme de Terminale) avec l’énoncé de Lacan dans La logique du fantasme, si abondamment commenté par Jacques-Alain Miller : « l’inconscient c’est la politique »[1]. Il faut comprendre l’énoncé « l’inconscient c’est la politique » sur fond d’un autre énoncé de Lacan : « l’inconscient c’est le discours de l’Autre », et l’énoncé de Freud « l’anatomie c’est le destin ». Car en effet, quand Lacan dit que l’inconscient c’est la politique, il le fait résonner avec cet énoncé de Freud. Lacan introduit la différence entre les sexes comme étant le fondement de l’énoncé « l’inconscient c’est la politique ». Et poussant les choses un peu plus loin, nous pouvons dire que la politique est ce qui vient au secours du non-rapport sexuel. Elle est ce qui fait lien avec l’Autre, l’Autre en tant qu’il est radicalement autre, l’Autre qui est tellement autre qu’il n’y a aucun rapport avec lui. On n’a pas besoin de politique, ni d’inconscient quand il y a rapport sexuel, par exemple quand la nature régule le rapport à l’Autre. En effet, si le rapport à l’Autre est régulé par des neurones, qui a besoin de l’inconscient ?
Ainsi par exemple, une chercheuse qui semble assez connue, Barbara Fredrickson, professeure à l’université de la Caroline du Nord, nous dit qu’une des conditions de l’apparition de l’amour, est « une synchronie entre les réactions biochimiques et le comportement de deux personnes (postures/gestes reproduits inconsciemment, phrases finies à la place de l’autre, réactions physiologiques à l’intérieur du cerveau comme la sécrétion d’ocytocine) »[2].
L’idée ne nous est pas complétement étrangère. Paula Heiman, disciple de Mélanie Klein, considérait que l’inconscient du patient pouvait provoquer une réaction émotionnelle du côté de l’analyste. C’est ce qui expliquerait le phénomène du contre-transfert qui permettrait à l’analyste d’extraire un savoir concernant l’inconscient de l’analysant. Lacan parle lui-même de l’amour comme supporté « d’un certain rapport entre deux savoirs inconscients » [3]. Il parle aussi de l’« inconscient transférentiel », c’est-à-dire un inconscient qui n’a de sens que dans la mesure où il se produit dans la cadre d’une relation à l’autre, plus précisément : l’analyste. Mais dans tous ces cas, cette relation est médiatisée par la parole, avec ce que cela implique de ratage, de malentendu foncier, qui font l’infini des modalités de rapport qu’un sujet, effet de signifiant, peut entretenir avec l’Autre. Pas de « synchronie biochimique » qui assure l’amour comme le prétend B. Fredrickson. Cette synchronie est le nom d’une grande illusion d’un rapport sexuel déjà-là, dès avant la rencontre, inscrit dans le cerveau, et sans faille. Cette illusion permet d’éviter la prise de risque incluse dans toute prise de parole.
Il faut bien dire que si les choses étaient ainsi, la vie serait beaucoup plus facile. Pas de tracas du genre : peut-être ne suis-je pas à la hauteur ? Voudra-t-elle de moi ? Comment l’aborder ? Que dire ? Oups je viens de faire un lapsus, elle ne va pas apprécier ? etc. Tout serait déjà programmé dans le cerveau avec lequel nous ferions Un. Vie plus facile, mais sans doute moins intéressante.
Tout comme l’inconscient qui est le discours de l’Autre, la politique, au sens démocratique du terme, implique une tolérance à l’existence de l’Autre. C’est pourquoi la politique se termine là où commencent le discours et les régimes totalitaires. La démocratie implique une tolérance aux divisions de la vérité, dit J.-A. Miller. C’est à dire qu’il n’y a pas qu’une seule vérité. À quoi j’ajouterai qu’il y a des positions de jouissance qui sont autres, l’une par rapport à l’autre, qui s’excluent, et qui déterminent le rapport aux vérités. Ainsi par exemple, l’antisémitisme ou la misogynie ne sont pas des opinions ni un savoir. Ce sont des positions de jouissance. Jamais on n’a pu changer la position d’un misogyne par une simple argumentation signifiante. Modifier la position d’un misogyne par rapport à la jouissance de l’Autre cela nécessite sans doute une analyse.
Cette division de la vérité, division de l’Autre, s’incarne dans la démocratie par la pluralité des parties politiques [4]. Une pluralité de parties politiques, cela implique une altérité présente et installée à jamais, dans l’illimité. Il n’y a pas de conciliation possible ni de réduction de l’Autre pluralisé au Un. Pour que la pluralité et la division de l’Autre se dissolve dans un conflit, pour qu’elle soit réduite à l’Un, il faut une guerre qui se résout par un vainqueur et un vaincu, ce qui devient rare de nos jours, me semble-t-il.
Une volonté de réduire la division de la vérité à l’Un
Dans ses « Intuitions milanaise »[5], J.-A. Miller éclaire les raisons de ce sentiment contemporain selon lequel nous vivons une ère de perte de repères. La psychanalyse est née comme réaction à l’ère « victorienne », l’ère de la discipline. Mais que se passe-t-il à partir du moment où les interdits s’évaporent et le langage ne vient plus contrecarrer la jouissance ? On passe alors du régime du désir au régime de la jouissance. On constate que la libération de la jouissance n’est plus régulée assez par des père-versions, par le phallus, et du coup, elle doit être régulée en termes de droits. On revendique le droit de chacun à la jouissance, souvent exposée sans entrave. Ce détachement de l’interdit n’implique pas une réduction des souffrances. Là où le sujet était esclave de l’interdit, il devient esclave de la jouissance. Dans ce nouveau régime, le père, et le signifiant-maître, même pluralisés, n’opèrent plus. On ne peut plus parler de négativation de la jouissance. Le totalitarisme à l’ancienne n’opère plus non plus. Même un dictateur ne pourrait pas tasser toutes les jouissances. Dans ces conditions, dit J.-A. Miller, ce qui se produit ce sont des bulles de la certitude. Ces bulles sont autant de revendication au retour de l’Un sans division qui va suturer les failles ouvertes une fois que l’Autre est barré. Ainsi, l’individualisme est une revendication à une zone de certitude qui vient répondre à la chute des frontières et des repères de l’époque de la globalisation. Il s’agit d’une revendication non seulement au droit de chacun de jouir selon le mode qui lui convient, mais aussi à faire Un avec sa jouissance, sans division.
Cela se constate aussi au niveau des figures qui mènent la politique dans le monde aujourd’hui. L’identification va vers celui qui élève le droit à son mode de jouissance à la hauteur d’un moi idéal. C’est ce que repèrent les politologues d’aujourd’hui. Avec les réseaux sociaux, les filtres institutionnels qui, jadis, faisaient qu’un leader avait dans la plupart des cas un minimum de formation culturelle, n’existent plus. Devient une personnalité connue et reconnue celui qui arrive à donner propagation virale à son mode de jouissance. Des identités collectives s’organisent aujourd’hui non seulement autour d’idéaux ou d’utopies plus ou moins délirantes, mais aussi autour de telles personnalités qui font Un avec leur jouissance, et le revendique. Trump en est le paradigme.
La constitution des neurosciences comme une des modalités de l’Autre contemporain peut se lire comme une telle revendication du retour à l’Un. C’est un appel à une conception de l’homme faisant Un avec son cerveau. Conscient et inconscient ne font pas deux dans ces constructions théoriques. Lacan a anticipé cette difficulté en déplorant le choix qu’a fait Freud d’intituler sa découverte « inconscient » ce qui donne à penser que l’inconscient est tout ce qui n’est pas conscient. C’est sur ce malentendu que les neurosciences bâtissent leur idée de l’inconscient, et à partir de là la considération que l’inconscient est une notion qu’on peut facilement rayer est vite faite. Ainsi, Lionel Naccache, autre figure éminente dans le domaine (neurologue et chercheur en neurosciences cognitives à l’institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, proche de Stanislas Dehaene), nous relate dans un article, que « ces dernières années, les progrès des neurosciences ont fait naître la possibilité d’observer la conscience dans le cerveau » [6]. Je vous épargne les noms des zones du cerveau dans lesquels on constate par l’imagerie cérébrale la présence d’une activité en état de conscience. Naccache précise que la condition nécessaire à cet état de conscience est que le cerveau soit en éveil. Un vaste ensemble des neurones du cortex cérébral doit être activé. Mais alors, interroge-t-il, les rêves ne sont-ils pas un état de conscience sans éveil ? Et il répond, non : « vu de l’extérieur, le dormeur n’a nullement l’air éveillé, mais son cerveau vient en fait d’être réactivé par sa formation réticulée ». À quoi sert cette étude de l’activité cérébrale si aussi bien l’état conscient et inconscient impliquent une activité repérée dans le cerveau ? Une chose est sûre : du point de vue du cerveau, ces deux états font Un. Ils sont difficilement distinguables.
Mais c’est la deuxième condition d’un état conscient qui me semble être la meilleure, comme on dit d’une blague : « un cerveau conscient n’est pas simplement un cerveau éveillé ; c’est également le siège d’une conversation neuronale très particulière qui opère entre des régions distantes du cortex ». C’est le terme de conversation qui me semble ici être amusant. Il s’agit d’un échange « d’informations » entre des partie des cerveaux. Mais l’usage du mot « conversation » montre bien que les neuroscientifiques ne peuvent s’empêcher de penser en termes de parole. La parole insiste dans leur jargon sous la forme de la conversation. Ce n’est pas l’analysant qui parle à son analyste, mais deux zones du cerveau qui conversent. C’est très obscur, car, mis à part l’activité synchronisée de deux zones du cerveau qu’on repère par IRM, on ne sait rien du contenu de cette « conversation ».
Ravalement de l’inconscient psychanalytique
On trouve dans les thèses neuroscientifiques par rapport à l’inconscient deux idées qui sont de fait une sorte de ravalement de l’inconscient. Quand elle se présentent comme opposées à celle de la psychanalyse, cela démontre plutôt une incompréhension de ce qu’est l’inconscient en psychanalyse. D’une part, on considère que le rêve n’est qu’un déchet de l’activité neuronale, qu’il n’a donc aucune utilité, et que la volonté de l’interpréter comme ayant un sens déterminé pour l’humain est non scientifique, un peu mystique, dépassée etc. D’autre part, l’inconscient est considéré comme étant le résultat de traces que les impressions du monde ont laissées sur le cerveau et qui par la suite fonctionnent chez le sujet de façon automatiques, à son insu. De là vient une prétention majeure des neurosciences par rapport à l’éduction et l’apprentissage. Car si nous apprenons des choses, c’est que le cerveau enregistre des traces, qui sont les fondements de la mémoire. Ainsi, si vous apprenez à conduire une voiture, ce savoir s’inscrit dans votre cerveau, et fonctionne ensuite à votre insu. Vous ne pensez pas à vos gestes lors que vous conduisez une voiture. Ça serait plutôt contre-indiqué. Cet apprentissage existe bien sûr. C’est une sorte de conditionnement, que le cerveau y participe ou pas. Mais il s’agit là, dans cette conception cognitiviste et behavioriste de l’apprentissage, d’une conception assez étroite de ce que veut dire apprendre et étudier, qui n’a rien en commun avec la notion de l’inconscient psychanalytique.
Quelle responsabilité ?
Par essence, cette nouvelle modalité de l’Autre que sont les neurosciences constitue une attaque à la psychanalyse qui, elle, entretient l’irréductibilité d’une division de l’individu par rapport à son inconscient et à sa jouissance, à condition qu’il fasse un choix éthique de se faire responsable au sens analytique du terme. La réduction de l’homme à son cerveau rend la responsabilité insituable. Si l’homme est son cerveau, s’il n’y aucune instance extérieure à cet organe, comment le rendre responsable de ce qui le constitue de naissance ? Par contre, si on considère que l’homme est né dans un monde de langage qui lui est Autre, s’il tombe à sa naissance dans un bain de langage qui le précède, cela implique qu’il puisse pendre une position éthique par rapport à son corps.
C’est donc l’inconscient, celui de la psychanalyse, cet Autre structuré comme un langage, qui permet de situer la question de la responsabilité en psychanalyse. Le sujet est responsable non seulement de ses actes, mais aussi de ce qui les motive à son insu, c’est-à-dire l’inconscient. Freud disait que le sujet est responsable de ses rêves. C’est dire qu’il doit y reconnaître la malveillance de ses pulsions. Lacan le disait à sa façon, affirmant qu’il n’y a de responsabilité que sexuelle, c’est-à-dire qu’on est responsable de ce dont on ne connaît pas le sens et la signification. Il ajoutait que « de notre position de sujet nous sommes toujours responsables ». Cette exigence est un genre de « terrorisme » disait-il, mais il n’empêche que « l’erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable ». Comme le dit J.-A. Miller, mieux vaut avoir affaire à quelqu’un qui vous veut du mal, qui le sait, et par conséquent en prend la responsabilité, que d’avoir affaire à quelqu’un qui vous veut du mal sans le savoir et que de ce fait n’en prend pas la responsabilité et ne souffre ni de honte, ni de culpabilité.
On peut considérer que la civilisation progresse (et ça se discute). Mais une chose est sure : le retour au règne du Un est une régression. C’est une régression par rapport à la découverte de Freud qui a bouleversé le monde, parce que Freud a ouvert un abîme dans le domaine de la science, et on sait la grande difficulté à laquelle il a été confronté quand il a présenté ses premières thèses à des neurologues de son époque. Le neuroscientisme contemporain qui s’attaque à la psychanalyse est une tentative pour nous ramener en arrière, au temps qui précède cette brèche que Freud a forcé dans le monde.
Leurs rêves et les nôtres
La psychanalyse a transformé le monde en amenant une causalité nouvelle et un réel nouveau. En faisant un effort de formuler cette causalité et ce réel, nous constatons que dans ce débat entre neuroscientime et psychanalyse, comme autour de la question de la misogynie que j’ai évoquée plus haut, il n’y a pas d’arguments qui vaillent, car il s’agit de position subjective.
Prenons un exemple. Un article récent d’une professeure de neurologie à la Sorbonne, sous le titre « La nouvelle interprétation des rêves » [7] se montre polémique par rapport à la position tenue dans le champ des neurosciences et qui consiste à dire que les rêves ne servent à rien, qu’ils n’ont aucun sens et qu’ils ne seraient « qu’une conséquence secondaire du fonctionnement nocturne du cerveau ». Si les théories freudiennes sur le rêve sont très populaires selon elle, elles n’ont malheureusement reçu aucune confirmation scientifique. Mais cela ne veut pas dire que le rêve ne sert à rien. Pour elle les rêves ont une fonction essentielle de soutien de l’homme, car ils constituent un entraînement lui permettant de mieux aborder les tâches de la vie. « En jouant mentalement les événements à l’avance, (l’individu) apprendrait à éviter les pires comportements et à garder les meilleurs ». Si par exemple un étudiant rêve à la veille d’un examen d’avoir oublié sa carte d’étudiant qui est la condition de pouvoir y participer, il sera bien enclin à vérifier qu’elle est dans son portefeuille avant de quitter la maison pour le lendemain. Ainsi, le rêve serait une sorte de coach intérieur que nous portons en nous, et qui nous permet de mieux étudier, éviter les erreurs, avoir un meilleur lien social, être plus empathique, etc. On constate, écrit Isabelle Arnulf, que quand on dort après un apprentissage, les performances s’améliorent par après. Comment apprend-on à être empathique par le rêve ? Elle explique : « Quelle femme n’a pas été une fois un homme dans un rêve ? ». Et elle continue : « Point d’homosexualité refoulée ici, malgré ce qu’explique la psychanalyse : il semble plutôt s’agir d’un exercice de notre capacité à nous mettre à la place de l’autre, qui inclut l’empathie ». Autrement dit, une femme qui rêve qu’elle est un homme s’entraîne à être empathique avec les hommes.
Quelle bonne nouvelle ! Non seulement pour les neurosciences le rêve est la conséquence d’un « activateur situé dans le tronc cérébral [qui] allumerait l’hippocampe, une zone profonde essentielle à la mémoire » et que le cerveau formerait alors de façon secondaire des images et des sensations issues de notre mémoire. Mais en plus, le rêve travaille au service des exigences du surmoi contemporain de notre monde globalisé : bien étudié, bien travailler, arriver à temps au travail, être empathique…
Pour le reste, l’homme n’est traversé par aucune jouissance ou vérité troublante qui le divise. Il fait Un même avec ses rêves qui sont en continuité avec sa personne.
Réalité et réel
Rien, dans cette théorie du rêve n’a avoir avec le rêve au regard de la psychanalyse. Pensons au fameux rêve rapporté par Freud, « Père ne vois-tu pas que je brûle ? » repris à plusieurs occasions par Lacan. Pour Freud, l’essentiel dans ce rêve est la réalisation du désir du père ayant perdu son enfant de revoir son fils encore quelques minutes, raison pour laquelle il n’est pas réveillé immédiatement par le début d’incendie dans la chambre d’à côté. Pour Lacan, ce qui réveille le père c’est le réel inclut par ce reproche terrible de l’enfant mort : « père ne vois-tu pas que je brûle », qui renvoie le père à ce réel de l’enfant mort, cette zone indicible de la douleur d’un père qui a perdu un enfant. Il y a là, dans cette perte réelle, un trou dans le symbolique, un réel qui résiste à tout apaisement par le signifiant.
On voit qu’aussi bien pour Freud que pour Lacan, l’incendie en tant qu’événement dans la réalité, est secondaire. Pour le neuroscientiste, au contraire, c’est mon hypothèse, le réel de cette anecdote se situerait dans les traces que l’incendie dans la chambre d’à côté a laissé sur le cerveau du père. Ces traces ont rappelé au père la mort de son fils par association neuronale et c’est ainsi qu’elles ont provoqué ce rêve où l’enfant vient dire au père « je brûle », et cela a eu une fonction importante, celle de réveiller le père pour éteindre l’incendie, etc. Ainsi, il ne s’agit pas là d’un réel qui aurait provoqué ce rêve. Tout se passe à un niveau de la trame d’une réalité qui se présente comme une surface sans rupture : le cerveau du père et l’incendie étant du même registre. On constate que cette réalité est pâle par rapport au réel dont il s’agit. Éteindre l’incendie, mettre de l’ordre dans la chambre ou appeler les pompiers n’a pas de commune mesure avec le fait d’affronter la perte d’un enfant. En fait dans cette réalité il n’y a pas de perte. Ce qui est récupérable n’est pas perdu. Par contre, la douleur provoquée par le réel de la perte d’un enfant, indomptable par le signifiant, creuse un trou dans la trame du symbolique, elle vient d’ailleurs, et c’est ce réel qui est mis en avant par ce rêve en tant que formation de l’inconscient.
Notre inconscient et le leur, un choix éthique : en vue de PIPOL 9
Comme je l’ai souligné plus haut, l’inclusion de l’Autre dans l’inconscient se déduit de la formule « l’inconscient transférentiel ». Dans son article « Notre sujet supposé savoir »[8], J.-A. Miller souligne la concomitance de ces deux termes. Il n’y a pas l’inconscient d’abord et le transfert ensuite. La position même de l’inconscient et le fait qu’il est opératoire tiennent au transfert comme supposition de savoir. Qu’est-ce que cela veut dire sinon que l’inconscient en psychanalyse implique une position et un choix éthique ?
J.-A. Miller dans le « Point de capiton » du 24 juin 2017 dit qu’en définitif le choix est une question de goût. « cela n’est pas pensé seulement au niveau des idéalités, les choix sont enracinés […] dans la jouissance du corps, ils sont enracinés dans le sinthome, suivant ce terme que nous employons après Lacan. Ceci, histoire de ne pas être les pharisiens de notre propre choix – ‘‘notre choix est le bon, et celui des autres, nécessairement mauvais’’ –, c’est une guerre du goût, selon l’expression si heureuse de Philippe Sollers » [9].
Mais nous ne sommes pas neutres sur cette question. L’amour de la vérité, la visée du réel et le désir de l’analyste sont des choix. Nous pensons que le choix des neurosciences de ne rien savoir sur l’inconscient est dangereux, car ce qui est rejeté du symbolique revient dans le réel et dans le pire des cas sous la forme du passage à l’acte.
* Texte issu d’une conférence prononcée à Clermont-Ferrand le 11 mai 2019 dans le cadre du séminaire d’étude « Orientation lacanienne et politique » de l’ACF Massif central.
[1] Miller J.-A., « Intuitions milanaises », Mental, n°11, décembre 2002, p. 9-21 & Mental, n°12, mai 2003.
[2] Fredrickson B., Ces micro-moments d’amour qui vont transformer votre vie, Paris, Poche Marabout, 2017.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 131.
[4] Miller J.-A., « Intuitions milanaises », op. cit.
[5] Ibid.
[6] Naccache L., « Quelqu’un a-t-il vu la cosncience », Comment la révolution du cerveau va changer nos vies, Cerveau & Psycho, numéro 100, juin 2018.
[7] Arnulf I., « La nouvelle interprétation des rêves », Cerveau & psycho, n°100, 2018, disponible en ligne : https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neurosciences/la-nouvelle-interpretation-des-reves-13352.php
[8] Miller J.-A., « Notre sujet supposé savoir », Lettre mensuelle, n°254, janvier 2007, p. 3-6.
[9] Miller J.-A., « Point de capiton », La Cause du désir, n°97, Paris, Navarin, novembre 2017, p. 91.