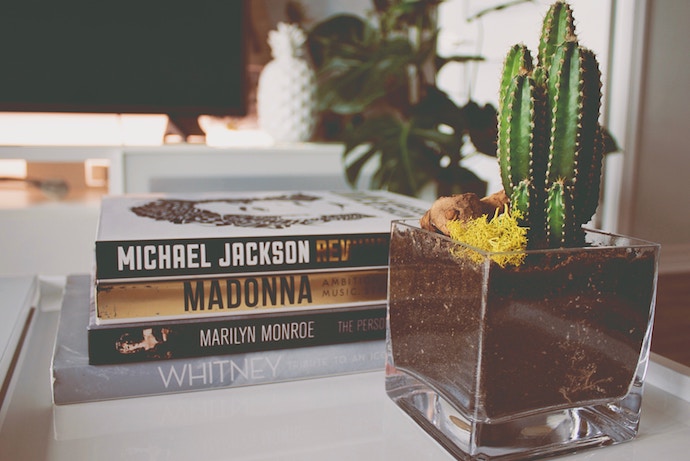Voix off, une femme interroge [1] : « Que recherchez-vous, Laurence Alia ? » Un homme répond : « Je recherche quelqu’un qui comprenne ma langue et qui la parle même ! Une personne qui, sans être un paria, ne s’interroge pas sur les droits et l’utilité des marginaux mais sur les droits et l’utilité de ceux qui se targuent d’être normaux. » La silhouette vue de dos d’une femme apparaît. Elle traverse la pièce puis sort dans la rue. À l’écran, les visages des gens qui se tournent et la suivent du regard se succèdent. Ils sont une galerie : l’étonnement, le jugement, le mépris, le désir, la peur, le manque à être, etc. Ainsi commence le film Laurence Anyways de Xavier Dolan sorti en 2012. Il y est question d’un homme, Laurence, qui annonce sa décision d’entamer sa transition en femme. Professeur de lettre et écrivain reconnu, il vit avec Fred, une femme qu’il aime intensément. Cela ne suffit pas à son bonheur, il est en train de crever de ne pouvoir montrer au monde cette évidence intérieure qu’il est une femme. Il désigne avec dégoût ses biceps, son sexe : « Ce n’est pas moi ça ! »
Quel serait le point de vue de la psychanalyse sur ces premières séquences ? Qu’ici, se dire femme ne suffit pas. Une reconnaissance, un droit – celui de vivre – cherche à s’inscrire dans l’Autre. Que Laurence cherche l’écho d’une langue intime. Que cet isolement dans la langue est l’expression d’une modalité du désir, modalité de satisfaction dans l’existence. Xavier Dolan explique qu’il n’a pas cherché à faire un film sur les transgenres mais sur la différence. Il avance qu’être trans, homo, relève d’un hasard. Nous pourrions traduire ainsi : ce qui fait événement sexuel pour un sujet, relève toujours d’une contingence, on ne peut présager à l’avance de ce que chaque affirmation recouvre.
Mettons en regard ce film avec celui de Lukas Dhont Girl sorti en salle en 2018, six ans après Laurence Anyways. Ce long métrage ne traite pas de l’obstacle que représenteraient les normes sociétales sur le choix transgenre. En effet, il est admis et accepté dès le début du film, par la famille et les médecins, que Lara, jeune garçon de 15 ans, apprentie danseuse classique dans une école renommée, pourra réaliser sa transition dès la puberté accomplie. Le traitement hormonal est d’ailleurs en cours. Sur ce point, on mesure le trajet parcouru en quelques années par les « minorités sexuelles », pour obtenir une reconnaissance sociale (droit, médecine corrective, etc.) Mais l’intérêt du film Girl ne réside pas là car cette reconnaissance sociale ne suffit pas à empêcher la castration réelle que ce sujet s’infligera après avoir croisé le regard de dégoût de ses camarades de danse sur son pénis. L’impératif irrépressible de supprimer l’organe se réalisera dans le réel.
Dans les deux films une question insiste au-delà de l’anatomie, elle concerne l’inscription dans l’Autre du langage. L’organe sexuel est dénaturé d’être pris dans le symbolique c’est-à-dire de dépendre, pour chacun, du désir de l’Autre qui toujours nous précède.
Dans la vie de Laurence, il y a deux femmes influentes : sa mère qui ferme les yeux sur la jouissance pornographique de son mari, et sa partenaire au prénom masculin : Fred. Un pas sera franchi pour Laurence lorsque sa mère, femme terne mais subtile lui dira qu’elle ne l’a jamais désiré comme garçon mais comme fille. Un autre pas sera franchi lorsque la perte de celle qui cause son désir, Fred, s’avère irrémédiable. La dernière image du film nous montre Laurence, tel qu’il pouvait paraître avant sa transition, rejoindre Fred vers, semble-t-il, un nouveau départ.
La détermination de Lara est autre, aucune subjectivation de sa position n’est souhaitée. Le bonheur de paraître femme est plein. L’articulation à l’Autre se fait pourtant à travers la place qu’offre le discours. Prenons par exemple sa satisfaction lorsque l’enseignante de son frère la désigne par le signifiant « sœur ».
Qu’est-ce qui peut entamer l’exil que crée ce hiatus entre le corps et l’Autre ? Dans son abord du sujet, la psychanalyse s’intéresse au rapport à la jouissance c’est-à-dire à cette matière insaisissable qui isole plus qu’elle ne rassemble, qui est une « […] espèce de drogue, mais bien plus variée que nos produits de synthèse – tout le monde est ainsi addict à quelque chose résultant de son existence-même » [2].
Prenons la jouissance « d’être femme ». Melvin Poupault qui incarne Laurence à l’écran explique qu’elle n’équivaut pas « au plaisir de mettre du rouge à lèvres, c’est un plaisir cosmique » dit-il. Ce terme évoque ce que Lacan dit dans le Séminaire XX à propos de cette autre jouissance, creusée dans une absence, rapportée à l’Autre plus qu’au phallus : « Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Ça arrive. Et qui du même coup s’en trouvent aussi bien. Malgré, je ne dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils entrevoient, ils éprouvent l’idée qu’il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà. C’est ça, ce qu’on appelle des mystiques. » [3] La jouissance nous renseigne sur l’infinie variété des réponses du sujet à l’énigme du sexe, une énigme qui s’appréhende dans l’expérience toujours singulière de la parole. On en parle dans une cure, ainsi que de ces fictions où se dévoile l’objet que l’on est pour l’Autre. Cet Autre n’est pas genré, il est adresse de parole dans le champ du langage et s’étaye sur la différence offerte par l’opposition signifiante des sexes. Il est en ce sens une fiction indispensable aux impasses de l’Un-tout-seul.
[1] Texte issu d’une table ronde « Homme, femme… Genre compliqué ! », dans le cadre du « Week-end Lacan », organisé du 12 au 14 avril 2019 à Toulouse, par l’ACF-Midi-Pyrénées.
[2] Alberti C., Enjoy !, publication en ligne, avril 2019 : https://colloquelacan.home.blog/enjoy-par-christiane-alberti/
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 70.