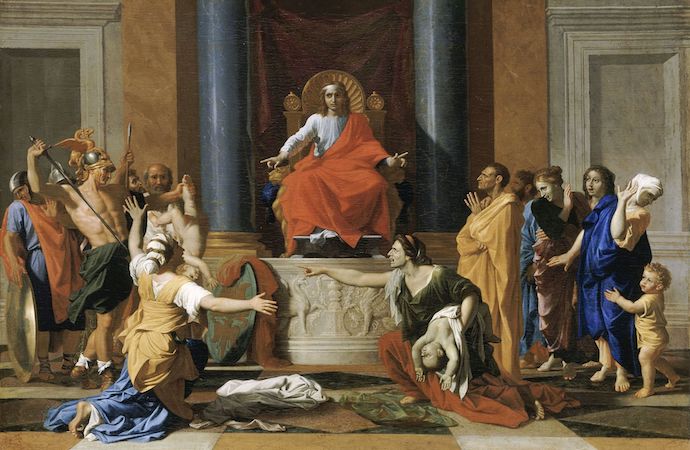Artiste franco-rwandais dans la trentaine, Gaël Faye écrit, chante, rappe. Lorsqu’il a une dizaine d’années, lorsqu’éclate la guerre civile dans son pays natal qu’est le Burundi, suivie du génocide des Tutsi au Rwanda, il quitte l’Afrique pour atterrir en France et passe son adolescence dans les Yvelines. Quelques jours avant de quitter le Burundi, il a déjà commencé à écrire, mais découvre alors le rap, au travers duquel il trouve rapidement une façon de créer à partir de la matière de son exil. Après des études universitaires dans la finance et deux ans de travail dans la même lignée à Londres, il décide de véritablement se consacrer à l’écriture et la musique. Il évolue dans un groupe de hip-hop et, rapidement, en 2013, il sort son premier album solo. Et de deux, et de trois. En 2016, il écrit son premier roman, Petit Pays, qui reçoit, pour sa plus grande surprise, un accueil dithyrambique, de nombreux prix et distinctions. Dans ce récit autofictionnel d’une sensibilité profonde et d’une grande poésie, il donne la voix à Gabriel, un jeune garçon métis, né d’un père français et d’une mère rwandaise qui conte son enfance au Burundi et assiste à la montée des conflits politiques entre Tutsi et Hutu, puis à leur guerre.
Je vous propose un petit voyage dans l’œuvre de ce jeune et brillant artiste, à partir de son roman, mais aussi de ses textes de rap et de ses témoignages précis quant au ressort de son travail d’écriture.
Mazouté par le génocide
Dans nombre de ses textes de rap, la prose de Gaël Faye traite déjà sous différentes coutures de la question de la guerre, ce qui lui permet d’y formuler : « Petit pays, je saigne de tes blessures » [1] . La vie de Gaël Faye s’enracine, déclame-t-il, dans un « petit pays d’Afrique des Grands Lacs » [2] , à la « réputation recouverte d’un linceul » [3] , et où « la vie ne tient qu’à une trajectoire d’objet métallique » [4] . Dans son texte « Petit Pays », qui a été une chanson avant d’être un roman, Gaël Faye écrit sur ce Burundi, pour se « remémorer [sa] vie naguère avant la guerre, trimant pour [se] rappeler [ses] sensations sans rapatriement » [5] . Cette guerre civile qui conduit à l’effroyable massacre ethnique que tout le monde connaît, entre Tutsi et Hutu et dont le petit Gaby du roman découvre avec incrédulité qu’ils s’entretuent pour l’absurde raison qu’« ils n’ont pas le même nez » [6] . Comme son auteur, son père est français et sa mère rwandaise, réfugiée au Burundi après les tueries perpétrées dans son pays une vingtaine d’années auparavant. Il a perdu un premier oncle maternel mort dans les rangs du Front patriotique rwandais, et en voit un second prendre le chemin de la même lutte. À Bujumbura, il a onze ans lorsqu’il apprend les couvre-feux, la terreur de sa mère et de sa tante lors d’un contrôle militaire, les opérations « villes mortes », les lynchages, les incendies d’écoles avec leurs élèves, les villages entiers ravagés. Il assiste à la montée de la folie de sa mère après qu’elle ait retrouvé les dépouilles de ses petits-cousins, assassinés dans le contexte d’un coup d’État, durant lequel on distribue machettes et listes de Tutsi à éliminer. Son regard d’enfant étonné sur l’actualité de son pays est néanmoins très vite affuté. Je vous en livre ici quelques passages témoins : « Dorénavant, les journées passaient plus vite, à cause du couvre-feu qui obligeait chacun à être chez soi à dix-huit heures, avant la tombée de la nuit. Le soir, on mangeait notre potage en écoutant la radio et ses nouvelles alarmantes. Je commençais à me questionner sur les silences et les non-dits des uns, les sous-entendus et les prédictions des autres. Ce pays était fait de chuchotements et d’énigmes. Il y avait des fractures invisibles, des soupirs, des regards que je ne comprenais pas. [7] »
« “Sales Hutu”, disaient les uns, “sales Tutsi” répliquaient les autres. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je suis entré dans la réalité profonde de ce pays. J’ai découvert l’antagonisme hutu et tutsi, infranchissable ligne de démarcation qui obligeait chacun à être d’un camp ou d’un autre. Ce camp, tel un prénom qu’on attribue à un enfant, on naissait avec, et il nous poursuivait à jamais. Hutu ou tutsi. C’était soit l’un soit l’autre. Pile ou face. Comme un aveugle qui recouvre la vue, j’ai alors commencé à comprendre les gestes et les regards, les non-dits et les manières qui m’échappaient depuis toujours. La guerre, sans qu’on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n’ai pas pu. J’étais né avec cette histoire. Elle coulait en moi. Je lui appartenais. » [8]
« Le génocide est une marée noire, ceux qui ne s’y sont pas noyés sont mazoutés à vie. » [9]
« […] le pays était un zombie qui marchait langue nue sur des cailloux pointus. On apprivoisait l’idée de mourir à tout instant. La mort n’était plus une chose lointaine et abstraite. Elle avait le visage banal du quotidien. Vivre avec cette lucidité terminait de saccager la part d’enfance en soi » [10] .
« Je trouvais le silence bien plus angoissant que le bruit des coups de feu. Le silence fomente des violences à l’arme blanche et des intrusions nocturnes qu’on ne sent pas venir à soi. La peur s’était blottie dans ma moelle épinière, elle n’en bougeait plus. » [11]
Lors d’une interview, Gaël Faye explique qu’il a choisi d’« écrire cette histoire à hauteur d’enfant » [12] , en premier lieu pour « dérouler » et saisir les événements qu’il avait lui-même vécus, mais également pour parvenir à intéresser et toucher le lecteur, là où les bilans chiffrés et leur aspect colossal la rendent inappréhendable ou insupportable. On peut dire que cet exercice d’autofiction est réussi : comme lecteur, on est emporté par Gabriel, on lui tient la main et l’on tremble avec lui lorsqu’il distingue de son regard singulier et enfantin la montée de l’horreur.
Semence d’exil
La thématique de l’exil palpite au cœur des paroles des chansons de Gaël Faye, qu’elle prenne la forme d’un horizon, d’une aspiration à quitter un mode de vie qui le « scandalise » [13] , à dévier la « vie tracée » [14] pour trouver du sens, ou qu’elle dise quelque chose de l’effet qu’a eu pour lui son exil passé, qui a laissé, je le cite, « [son] cœur mort sous les décombres » [15] . Dans le morceau « L’A-France », titre dans lequel il contracte « l’Afrique » et « la France », il scande ceci :
« L’AFRANCE est l’asile, l’absence et l’exil
Souffrance mais par pudeur faut pas que je l’exhibe
Je vis loin de mes rêves, de mes espoirs, de mes espérances
C’est ça qui me tue d’être écartelé entre Afrique et France. » [16]
Dans la chanson « Petit pays », il s’adresse au Burundi et à Bujumbura, sa ville natale, qu’il désigne comme « [sa] luciole dans [son] errance européenne ». Et livre cette autonomination : « Je suis semence d’exil d’un résidu d’étoile filante » [17] .
Notre Gabriel du roman n’a quant à lui pas le sentiment d’avoir quitté son pays – ce qui aurait impliqué qu’il ait eu « le temps de dire au revoir aux gens, aux choses et aux lieux qu’[il] a aimés » – mais de l’avoir fui, laissant « [sa] porte grande ouverte derrière [lui], sans [se] retourner » [18] . Quelques années plus tard, alors qu’on le devine adulte, venant « de si loin [qu’il est] encore étonné d’être là » [19] , il mesure qu’il « [lui] a fallu des années pour [s’]intégrer », mais éprouve néanmoins qu’il n’habite « nulle part ». « Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d’un lieu, l’anfractuosité de l’environnement. Ici, rien de tout ça. Je ne fais que passer. Je loge. Je crèche. Je squatte. » [20] Visionnant les infos diffusant des images d’arrivées de migrants accostant sur le sol européen, il déplore les fantasmes ignorants de l’opinion publique sur les raisons de leur fuite et regrette que l’on ne dise rien « du pays en eux » ; et ajoute en pensée : « La poésie n’est pas de l’information. Pourtant, c’est la seule chose qu’un être humain retiendra de son passage sur terre. » [21]
Lors d’une interview, Gaël Faye interroge le terme d’« intégration » qu’il dit peu apprécier, en ceci que, davantage qu’à l’intégration, c’est surtout à la désintégration qu’ont affaire les exilés : « la désintégration de ce [qu’ils ont] été par ailleurs » [22] , précise-t-il. Mais encore, dans d’autres témoignages précieux qu’il transmet sur son travail et sa propre histoire, il précise qu’en ce qui le concerne, contrairement à son narrateur Gaby, il n’avait aucunement sa lucidité sur les événements, au moment où la lutte armée a éclaté, et que c’est dans l’après-coup de son exil en France que s’est révélé le trauma de la guerre : « J’ai vécu ce sentiment d’insécurité pendant deux ans, confie-t-il. Vivre dans un pays en guerre est quelque chose de très particulier, on se dit que chaque jour est peut-être le dernier. Sauf que quand on a cet âge-là, dix ans, onze ans […], on le ressent pas tout de suite, et c’est l’arrivée en France, donc un pays en paix, qui m’a fait prendre conscience de ça. C’est comme s’il y avait eu une décélération, d’un coup, et cette peur-là est remontée à la surface, et je me souviens qu’une porte qui claquait se transformait en coup de feu, que quelqu’un dans un bar qui faisait tomber un verre, c’était tout de suite peut-être une grenade, il y avait une peur qui est restée pendant longtemps. […] [référence aux récents attentats à Paris] imaginez quand vous vivez ça tous les jours à quel point ça peut […] vous traumatiser » [23].
Exilé de l’identité
Si Petit Pays est également un roman traitant de la question de l’identité, Gaël Faye, encore une fois, a commencé à travailler le sujet dans les paroles de ses morceaux de musique. Dans son texte « Métis », il lie cette thématique à ses origines doubles :
« Regardez je suis brillant mais je reflète l’obscurité.
Identité de porcelaine, j’ai fait ce morceau-là
Pour assembler le puzzle d’un humain morcelé. » [24]
Dans le roman, le personnage de Gabriel, devenu adulte et parlant de ses rencontres séductrices avec les femmes, raconte la façon dont la question de son identité s’invite dans chacun de ses rendez-vous :
« “De quelle origine es-tu ?” Question banale. Convenue. Passage quasi obligé pour aller plus loin dans la relation. Ma peau caramel est souvent sommée de montrer patte blanche en déclinant son pedigree. “Je suis un être humain.” Ma réponse les agace. Pourtant, je ne cherche pas à les provoquer. Ni même à paraître pédant ou philosophe. Quand j’étais haut comme trois mangues, j’avais décidé de ne plus jamais me définir. […] mon identité pèse son poids de cadavres [25] ».
Le jeune Gaby, prend la mesure de l’importance, notamment pour sa mère et pour son meilleur ami Gino, de leur identité rwandaise – identité que sa grand-mère craint d’ailleurs que sa sœur et lui ne perdent avec l’exil, à ne pas parler kinyarwanda. D’un côté, sa mère les considère comme « des petits blancs, à la peau légèrement caramel, mais blancs quand même » [26] et de l’autre, Gino, moitié rwandais comme lui, l’épate, car il « [sait] exactement qui il [est] [27]» et l’encourage à acquérir « ce qu’il appelait une “identité” » :
« Selon lui, il y avait une manière d’être, de sentir et de penser que je devais avoir. Il avait les mêmes mots que Maman et Pacifique et répétait qu’ici nous n’étions que des réfugiés, qu’il fallait rentrer chez nous, au Rwanda. Chez moi ? C’était ici. Certes, j’étais le fils d’une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l’école française, Kinanira, l’impasse. Le reste n’existait pas » [28] .
Ce que son narrateur découvre alors, explique Gaël Faye dans une interview, c’est que la guerre lui « plaque », lui « impose une identité », alors même qu’il ne la choisit pas. « Lui qui se croyait enfant, complète Gaël Faye, tout d’un coup il devient métis, français, tutsi, rwandais » [29] .
Si Gabriel est un personnage de fiction, Gaël Faye n’en cache pour autant pas les effets de ses origines multiples sur son existence, à lui : « Je suis partout à ma place sans jamais vraiment l’être, confie-t-il. […] C’est une douleur et à la fois une richesse de pouvoir naviguer entre différents mondes sans pour autant y appartenir totalement, entièrement. […] Ce regard-là crée la complexité. Et le monde a besoin de complexité […], parce que rien n’est binaire. […] rien n’est tout blanc ou tout noir » [30]. Intelligemment, il décolle finalement la question du métissage de celle portant sur ce qui faire tenir ou non l’identité, considérant en somme que cette question touche au « malheur de nous autres, êtres humains », auxquels on assigne des identités à la naissance, dont il s’agit de se « départir en grandissant » [31] , tout en composant avec ceci que « l’identité n’est pas quelque chose de figé », mais « un mouvement » [32] permanent, considère-t-il. C’est cette identité toujours déjà désintégrée qu’il s’échine à loger dans ses morceaux, où il considère systématiquement traiter d’un « entre-deux ».
Exilé de l’enfance
Exilé de son petit pays, ou encore comme il rappe, de « [sa] rose, [son] pétale, [son] cristal, [sa] terre natale » [33] , Gaël Faye cherche, à travers ses chansons, à en restituer la lumière, les couleurs, le « ciel bleu paradis », le « soleil de plomb teigneux », les parfums de la terre défrichée et des bougainvilliers, le boucan des kasukus, la vie en « jardin d’Eden […] à ciel ouvert » [34] . Il poursuit cette œuvre par la voix de Gabriel, qui évoque l’étendue des paysages, le lac Tanganyika, les plaines immenses, mais encore la musique des langues ambiantes comme « le kirundi compliqué et poétique des collines » [35] , faisant « références à des proverbes immémoriaux et à des expressions qui datent de l’âge de pierre »[36]…
Mais encore, ce qui donne sa puissance au lieu, ce sont également les moments d’enfance, les aventures de copains dans la carcasse poussiéreuse d’un Combi Volkswagen, leurs épopées dans le petit paradis d’impasse où ils vivent, leurs orgies sucrées de mangues, leurs transgressions, leur incrédulité face aux comportements des adultes, leurs émerveillements, leurs « rires faciles » [37] … Et puis aussi le souvenir de Gaby de sa fête d’anniversaire :
« Je profitais de cette minute avant la pluie, de ce moment de bonheur suspendu où la musique accouplait nos cœurs, comblait le vide entre nous, célébrait l’existence, l’instant, l’éternité de mes onze ans, ici, sous le ficus cathédrale de mon enfance » [38] .
Et c’est vers cette enfance que Gabriel, adulte, se tourne, alors qu’il a entrepris un retour au pays :
« Je tangue entre deux rives, mon âme a cette maladie-là. Des milliers de kilomètres me séparent de ma vie d’autrefois. Ce n’est pas la distance terrestre qui rend le voyage long, mais le temps qui s’est écoulé. J’étais d’un lieu, entouré de famille, d’amis, de connaissances et de chaleur. J’ai retrouvé l’endroit mais il est vide de ceux qui le peuplaient, qui lui donnaient vie, corps et chair. Mes souvenirs se superposent inutilement à ce que j’ai devant les yeux. Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j’ai compris que je l’étais de mon enfance. Ce qui me paraît bien plus cruel encore. » [39]
Gaël Faye, lorsqu’il témoigne de l’écriture de ce livre, explique en effet qu’il a voulu en premier lieu écrire un livre qui lui permette de « recréer ce monde de l’enfance, ce monde de l’innocence, cette impasse, ces petits voleurs de mangues, cette insouciance » [40] , en retrouver les sensations, et pas tant celles du génocide et de la violence. Gaël Faye se dit exilé de sa propre enfance, tout bonnement, précise-t-il, « comme [l’est] chaque adulte » [41] , et explique que ce n’était ainsi pas tant le pays qui lui avait manqué que l’enfance qu’il y avait eue. « Trimant pour [se] rappeler [ses] sensations sans rapatriement », comme il le scande en rappant, il démêle l’exil de son enfance de l’exil forcé du Burundi et de la guerre qui ont bien évidemment également participé à la fin de l’insouciance, mais il met par ailleurs en lumière la façon dont le ratage du rapport entre ses parents, leur impossible couple, leur séparation, l’absence maternelle, sont aussi ce qui a commencé à lézarder le monde de l’enfance :
« Je ne connaîtrai jamais les véritables raisons de la séparation de mes parents. Il devait pourtant y avoir un profond malentendu dès le départ. Un vice de fabrication dans leur rencontre, un astérisque que personne n’avait vu, ou voulu voir. » [42]
« Le naturel s’est pris pour un boomerang et mes parents l’ont reçu en plein visage, comprenant qu’ils avaient confondu le désir et l’amour, et que chacun avait fabriqué les qualités de l’autre. Ils n’avaient pas partagé leurs rêves, simplement leurs illusions. Un rêve, ils en avaient eu un chacun, à soi, égoïste, et ils n’étaient pas prêts à combler les attentes de l’autre. Mais au temps d’avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et tout le reste, c’était le bonheur, la vie sans se l’expliquer. L’existence était telle qu’elle était, telle qu’elle avait toujours été et que je voulais qu’elle reste. Un doux sommeil, paisible, sans moustique qui vient danser à l’oreille, sans cette pluie de questions qui a fini par tambouriner la tôle de ma tête. » [43]
Puis durant la tonitruante dispute de séparation de ses parents :
« Les voix se mélangeaient, se distordaient dans les graves et les aigus, rebondissaient contre le carrelage, résonnaient dans le faux plafond, je ne savais plus si c’était du français ou du kirundi, des cris ou des pleurs, si c’était mes parents qui se battaient ou les chiens du quartier qui hurlaient à mort. Je m’accrochais une dernière fois à mon bonheur mais j’avais beau le serrer pour ne pas qu’il m’échappe, il était plein de cette huile de palme qui suintait dans l’usine de Rumonge, il me glissait des mains. Oui, ce fut notre dernier dimanche tous les quatre, en famille. Cette nuit-là, Maman a quitté la maison, Papa a étouffé ses sanglots, et pendant qu’Ana dormait à poings fermés, mon petit doigt déchirait le voile qui me protégeait depuis toujours des piqûres de moustique. » [44]
Ainsi, il me semble que c’est parce que Petit pays est aussi une histoire universelle, celle de l’enfance, que c’est un roman qui nous parle, nous touche autant et qu’une proximité s’établit entre le lecteur et le narrateur enfant, « parce qu’on a ressenti cet émerveillement, cette façon de découvrir les choses et le monde » [45] , propose Gaël Faye. Ainsi, il dit tâcher « d’être à la hauteur de l’enfant [qu’il a] été » [46] .
Dans l’écriture, trouver un pays
Alors, exilé de son pays natal, de son identité, de son enfance, que trouve Gaël Faye dans l’exercice de l’écriture, celle de nombreux textes de rap et celle d’un roman ? Son double autofictionnel qu’il a « mis à l’intersection de [ses] propres origines » [47] , Gabriel, trouve en sa voisine grecque, Mme Economopoulos, une salvatrice porte d’entrée à la littérature. Avec sa bibliothèque fournie, elle l’initie à l’idée qu’un livre peut changer quelqu’un et lui fournit alors, comme le formule Gaël Faye, une véritable « bouée de sauvetage » [48] :
« Je découvrais [en commentant les livres] que je pouvais parler d’une infinité de choses tapies au fond de moi et que j’ignorais. Dans ce havre de verdure, j’apprenais à identifier mes goûts, mes envies, ma manière de voir et de ressentir l’univers. » [49]
En revanche, si l’enfance a « laissé [à Gabriel] des marques dont [il] ne sai[t] que faire », Gaël Faye, quant à lui, prend la plume pour en faire quelque chose. Il a commencé à écrire quelques jours avant son départ du Burundi, et c’est devenu « une pulsion irrépressible » [50] , dit-il, qui l’a dès lors « poursuivi » [51] . Il précise : « ce moment de ma vie, et puis un moment de la vie du narrateur, on peut se dire que c’est une maladie, mais on peut aussi apprendre à vivre avec et puis même en faire une force. Contrairement au narrateur, lui, qui ne se sort pas de cette histoire-là, moi ça va » [52] . Dans un morceau, il explique que l’écriture constitue pour lui un véritable traitement dont il témoigne : « Une feuille et un stylo apaise mes délires d’insomniaque », « l’écriture m’a soigné », « j’ai gribouillé des textes pour m’expliquer mes peines » [53] . Son rap, témoigne-t-il, est pour lui devenu un « trépied », en prêtant sa voix « aux crève-la-faim et traîne-savates » [54] , comme il le formule. À travers l’écriture et le rap, il a dès lors pu briser une certaine solitude en rencontrant « d’autres sensibilités » [55] à qui ses textes parlaient. Au cours d’une interview, il s’exerce à préciser : « Toute la démarche de ma vie, c’est de créer ce territoire qui engloberait la France, le Rwanda, le Burundi en un seul. […] C’est une façon pour moi de rassembler mon humanité morcelée » [56]. Et lors de sa remise du prix Goncourt des lycéens, en 2016, ému, il témoigne : « dans l’écriture j’ai trouvé un pays » [57] .
Avec Petit Pays, Gaël Faye a voulu prolonger cette expérience de l’écriture, en produisant un texte plus long qu’une chanson, et il y parvient admirablement. À partir de l’histoire terrible de son exil du Burundi, il dégage et explore les exils qui sont universellement le propre de l’humain (puisque, tient-il à préciser, « c’est l’humanité qui [l]’intéresse » [58] ) – exploration poétique, donc, au travers de la voix d’un enfant qui bientôt n’en sera plus un.
[1]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[2]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[3]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[4]. Faye G., « By », Des Fleurs, 2018.
[5]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[6]. Faye G., Petit Pays, Grasset, 2016, p. 10.
[7]. Ibid., p. 124.
[8]. Ibid., p. 133.
[9]. Ibid., p. 185.
[10]. Ibid., p. 196.
[11]. Ibid., p. 197.
[12]. Faye G., « C à vous », France 5, le 5 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=APGQoUQ7euU).
[13]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[14]. Faye G., « Tôt le matin », Rythmes et botanique, 2017.
[15]. Faye G., « Je pars », Pili-pili sur un croissant au beurre, 2013.
[16]. Faye G., « L’A-France », Pili-pili sur un croissant au beurre, 2013.
[17]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[18]. Faye G., Petit Pays, op. cit., p. 211.
[19]. Ibid., 2016, p. 15.
[20]. Ibid., p. 13.
[21]. Ibid., p. 16.
[22]. Faye G., « Thé ou café », France 2, le 25 mars 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=hBmG4SZnqkQ).
[23]. Faye G., « On n’est pas couché », France 2, le 24 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=rMgWFx67JYw).
[24]. Faye G., « Métis », Pili-pili sur un croissant au beurre, 2013.
[25]. Faye G., Petit Pays, op. cit., p. 14.
[26]. Ibid., p. 69.
[27]. Ibid., p. 82.
[28]. Ibid., p. 83.
[29]. Faye G., « C à vous », France 5, le 5 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=APGQoUQ7euU).
[30]. Faye G., « Entrée libre », France 5, le 19 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=2EZG2lQbOmA).
[31]. Faye G., « C à vous », France 5, le 5 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=APGQoUQ7euU).
[32]. Faye G., « On n’est pas couché », France 2, le 24 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=rMgWFx67JYw).
[33]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[34]. Faye G., « L’ennui des après-midi sans fin », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[35]. Faye G., Petit Pays, op. cit., p. 54.
[36]. Ibid., p. 55.
[37]. Ibid., p. 77.
[38]. Ibid., p. 110.
[39]. Ibid., p. 213.
[40]. Faye G., « La Grande librairie », France 5, le 2 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=0nYVL-W7fPQ).
[41]. Faye G., « C à vous », France 5, le 5 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=APGQoUQ7euU).
[42]. Faye G., Petit Pays, op. cit., p. 17.
[43]. Ibid., p. 18-19.
[44]. Ibid., p. 34-35.
[45]. Faye G., « L’invité », TV5 Monde, le 18 octobre 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=J6Yk4CQYl_8).
[46]. Faye G., « Thé ou café », France 2, le 25 mars 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=hBmG4SZnqkQ).
[47]. Faye G., « La Grande librairie », France 5, le 2 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=0nYVL-W7fPQ).
[48]. Ibid.
[49]. Faye G., Petit Pays, op. cit., p. 171.
[50]. Faye G., « Thé ou café », France 2, le 25 mars 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=hBmG4SZnqkQ).
[51]. Faye G., Discours lors de la remise du prix Goncourt des lycéens 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=dmC-7sZbaIE).
[52]. Faye G., « La Grande librairie », France 5, le 2 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=0nYVL-W7fPQ).
[53]. Faye G., « Petit pays », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[54]. Faye G., « Charivari », Pili-Pili sur un croissant au beurre, 2013.
[55]. Faye G., « C à vous », France 5, le 5 septembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=APGQoUQ7euU).
[56]. Faye G., « Thé ou café », France 2, le 25 mars 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=hBmG4SZnqkQ).
[57]. Faye G., Discours lors de la remise du prix Goncourt des lycéens 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=dmC-7sZbaIE).
[58]. Ibid.