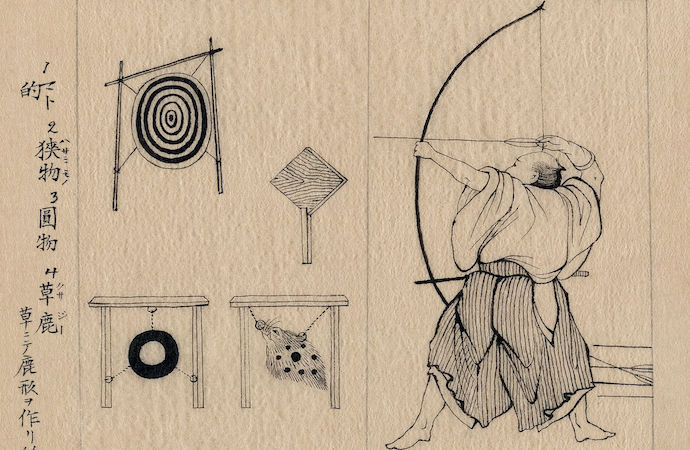Le titre de cette soirée, « Le passeur, une question pour l’AME » me paraît situer la place et la fonction de l’AME dans notre École de façon pertinente [1]. En effet, le titre d’AME a toujours subi une certaine déflation de la part de Lacan qui n’a cessé de déprécier ce titre qui indiquait la compétence liée à l’expérience plutôt qu’à un désir inédit. Dans la conclusion donnée au Congrès sur la passe [2] et la transmission à Deauville, en 1978, non seulement il dit que la passe est un échec, mais il fait le constat que ceux qui s’y présentent, sont des AME et ça ne l’intéresse pas d’avoir le témoignage des analystes confirmés pour saisir ce moment où on s’autorise à devenir analyste.
Il y a, si on se réfère aux textes de Lacan, un gap entre l’AME et l’AE, celui qui dirait « ce qui lui est passé dans la boule pour s’autoriser à être analyste ». Il me semble qu’aujourd’hui, cette question du passage de l’analysant à l’analyste n’est pas au centre de la passe, c’est la fin de l’analyse comme solution sinthomatique qui est attendue pour nommer un AE. Il y a plusieurs causes à ce déplacement mais ce soir, la question n’est pas directement centrée sur ce point.
Elle interroge l’AME en tant qu’il a à désigner son analysant comme passeur, désignation qui a des conséquences dans l’analyse de ce dernier mais aussi l’implique dans l’École et de fait, l’en fait responsable. En effet, cette désignation n’est pas seulement un acte qui introduit un analysant à prendre une place ou une fonction dans l’École comme participer à l’une de ses actions, à écrire pour les Journées d’Automne, etc. Ce sont des actes de l’analyste qui ont des effets interprétatifs dans une cure mais la désignation du passeur est d’un autre registre. Elle noue à l’acte de l’analyste, L’École de la passe par la désignation de celui qui va être projeté dans le dispositif le plus pointu et le plus essentiel de la transmission de la psychanalyse. Et de ce fait, elle donne à l’AME l’occasion de prendre sa part dans le fonctionnement de la passe.
En ce qui concerne l’analysant, le signifiant passeur est à lui seul la marque de cette irruption de la passe dans son parcours. Ce n’est pas n’importe quel signifiant. C’est un signifiant marqué d’une histoire et d’un désir, celui de Lacan, et qui perdure. Il pourra en tirer quelques conséquences concernant sa propre analyse mais aussi le désir de son analyste. Il devra s’acquitter d’un certain savoir pour assurer le bon fonctionnement de la procédure. Il aura à accueillir le passant pour que son témoignage se fasse dans des conditions optimales de confiance. Le passeur est celui qui rencontre le passant, recueille son témoignage et se fait page blanche pour en transmettre le vif. Il s’agit d’être à la hauteur de cette tâche. Le passeur doit aussi être capable de se laisser guider par les diverses façons dont le passant veut témoigner. Rien n’est écrit sur ces modalités et le principe du témoignage impose de laisser le passant choisir le nombre de séances dont il a besoin pour le faire, la façon dont il va parler à l’un et à l’autre simultanément ou plutôt successivement, etc. Le passeur doit faire preuve d’une certaine souplesse pour laisser le passant faire son témoignage selon ses propres choix. Mais surtout, le passeur doit être capable de prendre le témoignage à la lettre, ce qui signifie qu’il doit pouvoir en transmettre la logique et les points cruciaux en étant le plus fidèle au discours du passant. Il s’agit en effet, d’une transmission authentique qui requiert l’attention et la littéralité à la parole du passant.
Nous n’avons pas énormément d’écrits nous indiquant sur quels critères nous appuyer pour désigner un passeur. D’où notre responsabilité dans ce choix. Responsabilité sans pour autant la garantie absolue qu’il sera « un bon passeur », formulation qui semble vouloir dire quelque chose et qui circule dans les Commissions de la passe successives. Faut-il y voir une appréciation, voire une reconnaissance du passeur idéal ? Ce choix du passeur repose pourtant sur une lecture du moment où se trouve cet analysant dans sa cure plutôt que sur une évaluation de ses capacités à faire le passeur. Fait-on d’ailleurs le passeur ? « Le passeur est la passe »[3], a dit Lacan. Formule énigmatique et qui relève pourtant d’une définition sans compromis. Être passeur ne s’apprend pas, ne se transmet pas. C’est une expérience. Certes, le passeur devra en cerner les contours, ni analysant ni analyste mais les deux à la fois, pas sans le désir de savoir qui les anime.
C’est aussi par le biais du passeur que l’AME se connecte avec la passe. En le désignant passeur, l’analyste en question considère que son analysant a atteint un certain point dans son analyse où il reconnaît ce moment particulier de passe défini par J.-A. Miller comme la passe 1, celle qui a lieu dans l’analyse. Avons-nous des critères, des lectures de ce moment de passe ?
En ce qui me concerne, je pourrai indiquer deux points qui m’ont permis de m’orienter dans cette décision. Le premier concerne le moment où l’analysant a pris la mesure de sa position dans l’Autre et ses conséquences, à savoir qu’il a pu avoir une idée de la façon dont il était prisonnier de son mode de jouir. Lacan le dit dans son Séminaire « Le moment de conclure ». Il s’agit, dans une analyse de « savoir ce dans quoi on est empêtré » [4]. L’autre repérage qui permet de situer le moment de passe, est la chute du sujet supposé savoir qui survient quand l’analysant éprouve l’usure du déchiffrage et s’interroge sur la suite de son analyse. C’est ce questionnement nouveau qui constitue le virage où s’amorce le changement qui va de la fin du déchiffrage et de l’amour de la vérité vers le réel du sinthome.
Il est délicat de transmettre un exemple singulier mais j’en donnerai tout de même un aperçu. Pour cet analysant, le travail analytique a isolé la formule du fantasme : se faire l’objet déchet et a permis son extraction. Un rêve est venu préciser l’après-coup de cette traversée : il s’agit de l’apparition d’une sorte de marionnette que le sujet traîne avec lui et qui incarne, selon lui, la pulsion de mort, soit sa part de jouissance méchante et mortifiée qu’il isole dans le rêve et dont il prendra la mesure dans la suite de son analyse.
La désignation comme passeur veut aussi toucher à l’accès vers l’École. Elle se veut une interprétation calculée d’un « tu peux en être », d’une autorisation à y loger son désir d’analysant au service de la cause analytique. Et cela, par la passe qui constitue un engagement dans l’École qui est un des noms du désir de l’analyste. C’est un pari sur l’École de la passe dont le passeur se fait le joint, celui qui porte l’expérience de la transmission avec son corps, – celui du passant étant justement relativement effacé dans la procédure. C’est cette présence‑absence entre le passeur et le passant qui fait tout l’enjeu d’une transmission, l’obtention du titre d’AE restant à la charge de la Commission qui, du témoignage, fera le pari de la passe 3. Le passeur reste dans l’ombre. L’AE brille. Mais tous les deux ont su faire entendre un témoignage de passe qui passe…
[1] Intervention lors de la Soirée de la garantie, « Le passeur, une question pour l’AME », organisée par la commission de la garantie de l’École de la Cause freudienne, 18 mars 2019.
[2] Lacan J., « Conclusions », Lettres de l’École freudienne de Paris, n° 23, 1978.
[3] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 243-259.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XXV, « Le moment de conclure », leçon du 10 janvier 1978, inédit.