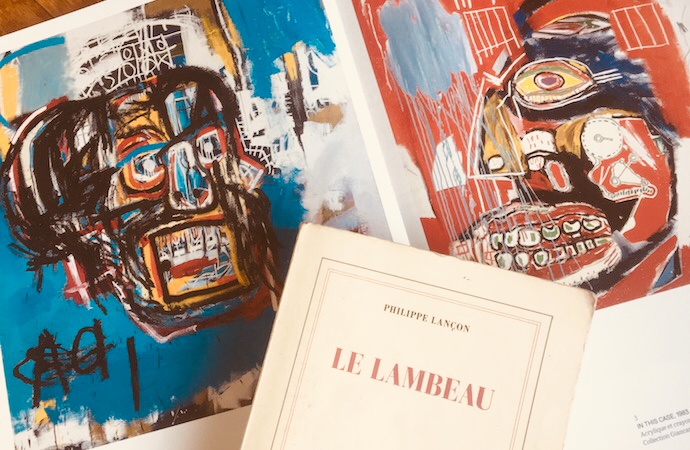« Tout le monde est fou (…) ça pointe vers un au-delà de la clinique, ça dit que tout le monde est traumatisé, qu’il y a quelque chose qui est pour tout le monde, c’est-à-dire qui est pour l’ensemble de ceux qui parlent, ceux qui sont de l’espèce parlante, pour qui la parole et le langage ont fonction et champ, même si eux-mêmes balbutient ou se taisent, se renferment. Et ce qu’il y a pour tous ceux-là c’est un trou » [1].
Cette phrase rend compte de la rencontre de tout un chacun avec le trou dans l’Autre du discours, avec le hors sens d’une jouissance qui se répète et rend le sujet étranger à lui-même. Tout le monde est traumatisé. Que tout le monde le soit, hors du discours de la psychanalyse, semble une évidence aujourd’hui. Traumatisme : signifiant maître de notre époque.
C’est de l’empire de ce signifiant et de son abord politique que traite l’ouvrage de Didier Fassin et Richard Rechtman L’Empire du traumatisme [2]. L’argument des auteurs est que le traumatisme connaît aujourd’hui un tel succès en tant qu’il est « une forme de reconnaissance sociale » [3], et « le produit d’un nouveau rapport au temps, à la mémoire, au malheur et aux malheureux, qu’une notion psychologique a permis de nommer » [4].
Du traumatisme, l’on pourrait dire qu’il est une interprétation. Attentats, catastrophes, marquent une discontinuité qui renvoie à la temporalité du trauma, celle de l’instant, laquelle caractérise aussi la temporalité de notre époque. Histoire(s) brisée(s), images fragmentées de l’horreur cernent le sujet. Fassin et Rechtman montrent de quelle façon cette interprétation et sa construction, au cours des deux siècles derniers, sont marquées par deux temps : le soupçon et l’authenticité.
C’est Charcot qui ouvre la voie de la psychiatrie du traumatisme à partir des constats faits par les médecins londoniens sur les accidentés ferroviaires, au moment de l’essor du chemin de fer, à la fin du XIXe siècle. Il faudra attendre Freud et Janet pour que l’étiologie psychique soit introduite dans les théories du traumatisme.
Pour Fassin et Rechtman cette époque ouvre sur ce qu’ils appellent « l’ère du soupçon ». À cette époque, la névrose traumatique ouvre un droit à réparation, notamment financier, du fait de sa nature d’agent causal extérieur. Apparaît, alors, la thèse selon laquelle certains ouvriers « préfèrent » d’être malades que de servir la Nation par leur travail et le terme de « maladie de revendication ». Le soupçon est renforcé par leur attente d’une compensation financière, et par leur « soi-disant » incapacité à reprendre le travail. Le même soupçon se manifeste à l’encontre des soldats traumatisés de la Première Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale, et notamment l’expérience des survivants des camps, marquent un premier tournant. Alors qu’auparavant la parole des traumatisés était mise en doute, elle est maintenant reconnue.
La fin de l’ère du soupçon n’adviendra pourtant qu’en 1980 avec la création du DSM III et du PTSD [5]. L’intitulé de PTSD, en mettant en avant un « trouble », va éliminer le terme de névrose.
Cette décision politique marque la fin de près d’un siècle de suspicion à l’encontre des victimes. C’est au tour de l’événement traumatique de changer de statut. Il devient l’agent causal « nécessaire et suffisant » au diagnostic. C’est son caractère intolérable qui est désormais pointé. Dès lors, une nouvelle ère du traumatisme commence.
Pour en rendre compte les auteurs s’appuient sur trois enquêtes qu’ils ont menées dans les années 2000 et notamment sur l’action de psycho-traumatologie de l’exil auprès des demandeurs d’asile qui révèlent des phénomènes de ségrégation.
Pour ces sujets, une attestation de leur traumatisme est devenue une des pièces centrales légitimant leur demande. En effet, aujourd’hui le récit du sujet est systématiquement mis en doute.
C’est le retour du soupçon. Au nom de la vérité, l’Union européenne invoque une tentative d’identifier les migrants illégaux et de lutter contre le terrorisme grâce à un nouveau système algorithmique [6]. Un projet pilote, financé de quatre millions d’euros, va être installé à des postes frontières en Grèce, Lettonie et Hongrie, dans le courant de l’année 2019. Le système de détection automatique des mensonges doit déterminer si une personne ment ou dit la vérité à partir des signes hors parole. Le « diagnostic » de la machine déterminera les voyageurs potentiellement à « risque ».
Nous voyons ainsi advenir la prophétie lacanienne : « Nous croyons que l’universalisme, la communication de notre civilisation homogénéise les rapports entre les hommes. Je pense au contraire que ce qui caractérise notre siècle, et nous ne pouvons pas ne pas nous en apercevoir, c’est une ségrégation ramifiée, renforcée, se recoupant à tous les niveaux, qui ne fait que multiplier les barrières » [7].
[1] Miller J.-A., « Vie de Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 17 mars 2010, inédit.
[2] Fassin D, Rechtman R., L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion 2011.
[3] Ibid., p. 416.
[4] Ibid., p. 405.
[5] Post-traumatic stress disorder (PTSD).
[6] The Guardian, EU border ‘lie detector’ system criticised as pseudoscience, le 2 novembre 2018.
[7] Lacan J., « Note sur le Père », La Cause du désir, n°89, Paris, Navarin, Mars 2015, p.8.