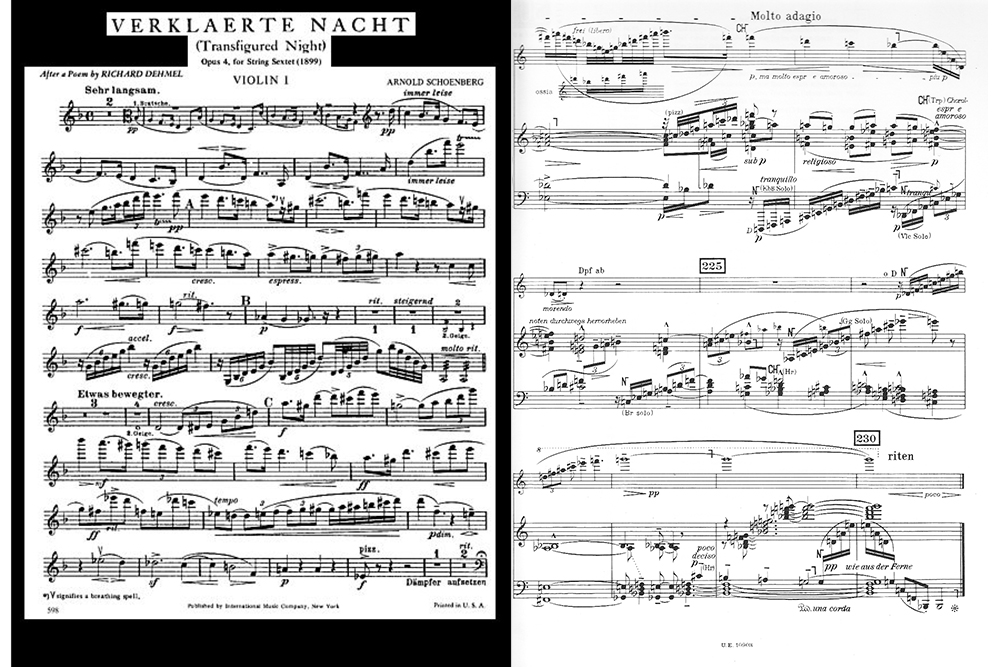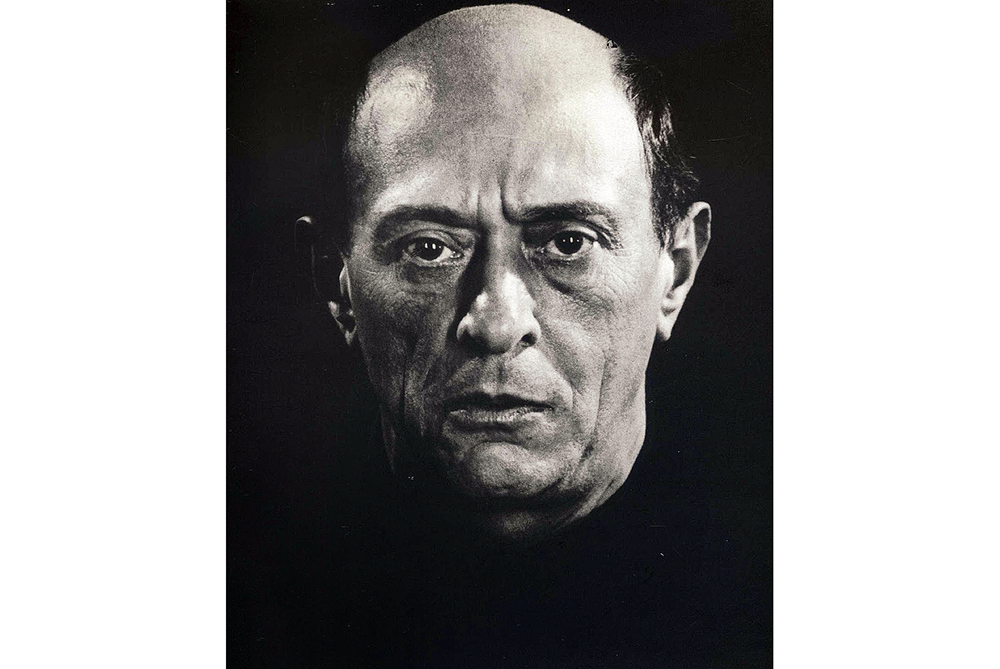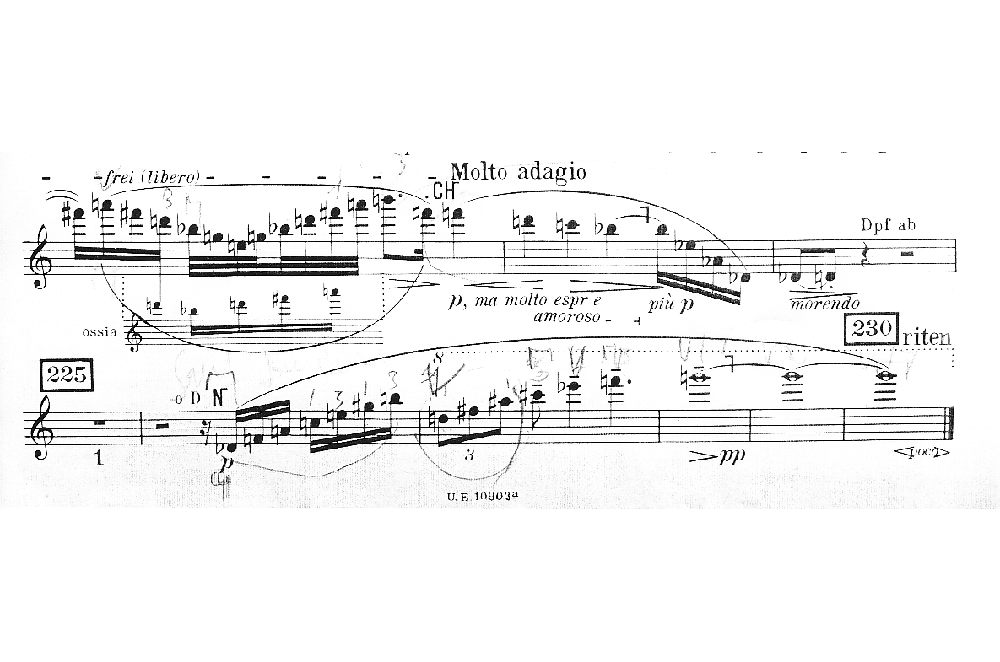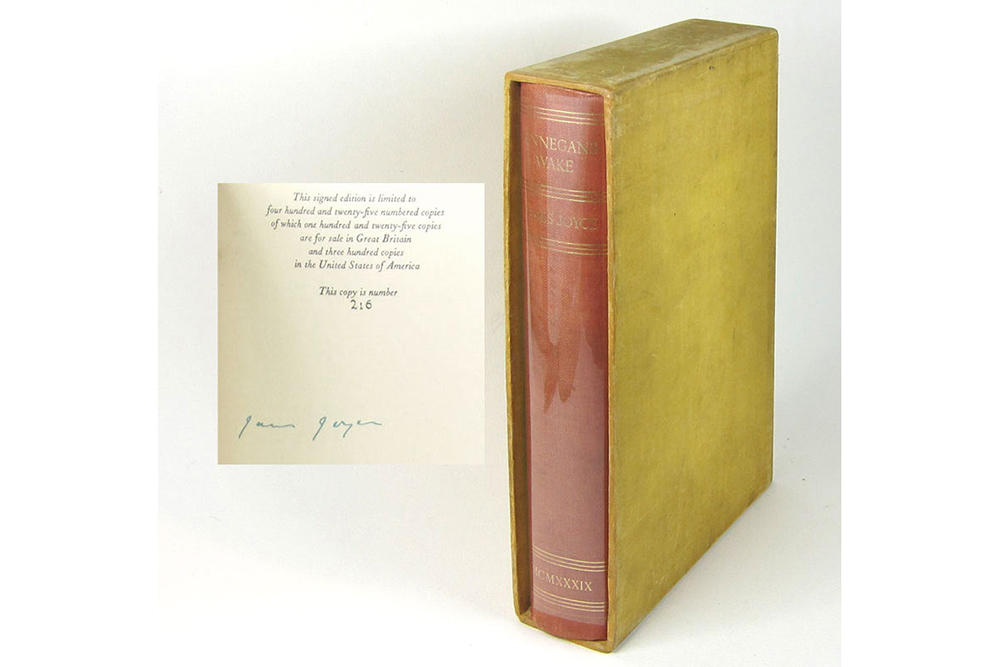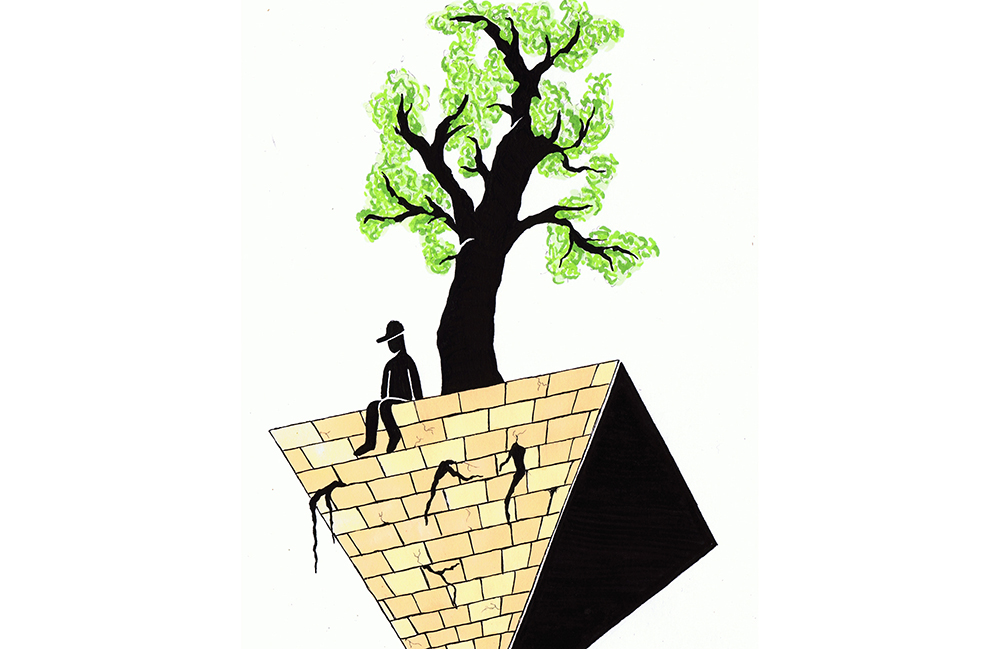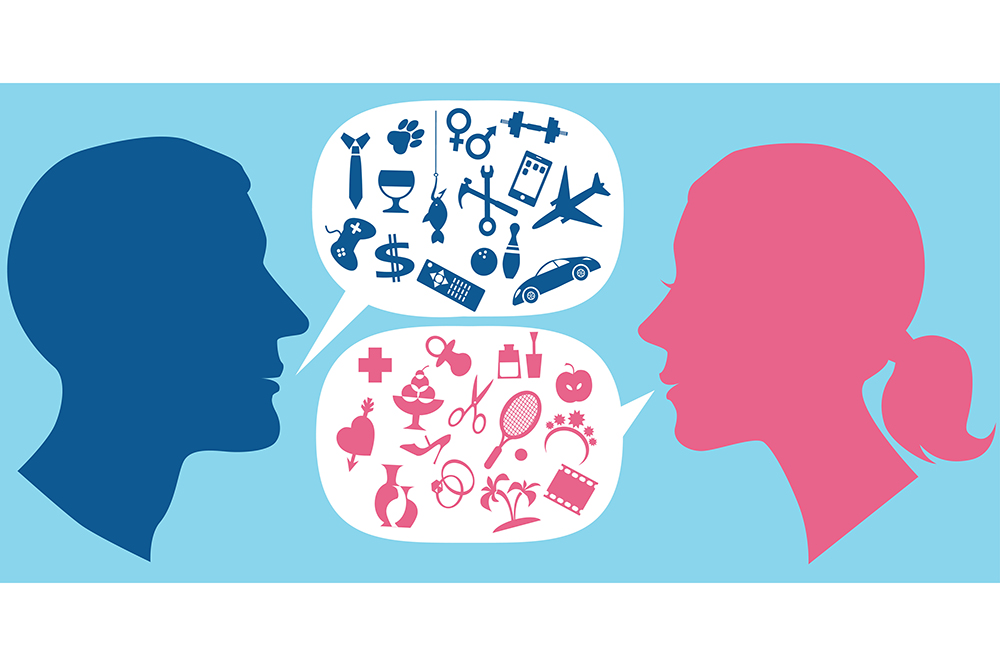Mme L. vient au CPCT-parents sur un point précis, des angoisses morbides éprouvées à l’égard de ses deux filles, âgées de cinq et deux ans et demi. Ce sont précisément des pensées de meurtre : « ça travaille tout seul, dit-elle, je prends un couteau et l’idée de les tuer me vient à l’esprit ». D’emblée, Mme L. dit avoir des angoisses de séparation avec ses propres parents, notamment sa mère. Elle reporterait cela, dit-elle, sur ses propres enfants. Elle pense tout le temps, en pleurant, au départ de ses filles plus tard.
Le chantage maternel
Mme L. a peur d’envahir ses filles avec ses angoisses parce qu’elle a connu ça avec sa propre mère. Elle est fille unique, sa mère ne la laissait pas sortir et la décourageait dans ses projets. Celle-ci accepte toujours mal le fait que Mme L. soit en couple, alors que cela fait dix-sept ans qu’ils sont ensemble. Si elle rencontre son mari à l’âge de dix-huit ans, Mme L. n’est pourtant partie du domicile parental qu’à vingt-cinq ans, à cause du chantage maternel : « si tu pars, il n’y aura pas de retour en arrière ». C’était donc une coupure quand elle est partie, elle l’aurait « trahie ». Mme L. étant fusionnelle avec sa mère, elle interprète qu’elle fait pareil avec ses enfants. Au contraire, je soulignerai les efforts qu’elle fait pour ce ne soit pas le cas. Venir parler, notamment, ou avoir pris la décision de se marier et d’avoir deux enfants.
L’enfant méchante
Mme L. fait beaucoup de cauchemars et ressent une profonde fatigue. Des choses violentes de son enfance ressurgissent après le premier entretien au CPCT. Elle avait toujours l’impression de gêner sa mère et son père. Un point important : ses parents lui laissaient croire qu’elle avait des arrières pensées, qu’elle était méchante – culpabilité écrasante qu’on lui injectait. Enfant, elle était timide, mais il lui arrivait de « piquer des colères ». Alors les parents lui disaient qu’elle jouait un double jeu. Ou bien, quand elle pleurait, elle n’en avait pas le droit car, disaient-ils, « il ne faut pas être un faible dans la vie ». Je souligne auprès d’elle, de manière ironique, qu’elle a eu droit à tout.
L’apparition des « pensées de meurtre »
À dix-huit ans, la pensée de tuer ses parents lui vient. Mme L. se disait alors qu’elle pouvait devenir folle et est « tombée en dépression ». Elle a peur de devenir le monstre qu’elle a peur d’être. La pensée d’être méchante vient de l’enfance. En tout cas, elle le construit comme tel, en évoquant un souvenir : sa mère a fait une fausse couche deux ans après sa naissance. Elle suppose que comme il n’y a pas eu d’enfants après, elle a dû se sentir coupable de cette mort étant petite : « J’ai dû me dire : il n’y a pas d’autres enfants parce que je ne suis pas sage, je suis méchante ». Sa mère lui a raconté la fausse couche d’une manière bizarre qui lui a fait penser qu’elle l’incluait dans cette mort. Voici le récit de l’épisode : elles ramassaient des châtaignes ensemble ; Mme L. a alors tapé sur une châtaigne en disant « J’ai tué la châtaigne ». Ensuite, sa mère a fait la fausse couche.
Cela aurait donc été prémonitoire : « c’est bizarre qu’elle me l’ait dit comme ça, souligne Mme L., j’aurais donc tué un enfant ». Lorsque je montre mon étonnement de manière prononcée, Mme L. en rit, mais elle précise que c’est resté gravé, et qu’elle s’est construite fondamentalement là-dessus. La séparation d’avec sa mère était tellement dure qu’elle se punit d’être partie, avance-t-elle, et de l’avoir laissée.
Des angoisses « personnelles »
Les premières séances au CPCT produisent un effet : elle dit se rendre compte que ses angoisses de mort, c’est « personnel ». Elle tente de ne plus les relier à ses filles. Mme L. fait également part d’une forte angoisse quant à la reprise du travail, car cela implique de laisser ses filles. Je lui dis qu’elle redoutait de les abandonner comme elle pensait l’avoir fait avec sa mère.
De plus, les trajets en voiture lui semblent très complexes à réaliser avec les angoisses qu’elle ressent. Je l’incite tout de même à aller au travail, lieu où elle peut avoir des pensées morbides, mais « comme tout prof ». Cela ne porte pas à conséquence.
Aujourd’hui elle a un réseau d’amis mais elle se compare aux autres et se rend compte qu’elle est angoissée plus que les autres, qu’elle voit tout au dramatique : « Je ne sais pas comment faire avec le lien social, dit-elle, je dois me réajuster sans cesse. Petite, j’étais sauvage ».
Faire couple, avec qui ?
Se « réajuster » est un signifiant à partir duquel orienter le transfert. Si elle laisse sa mère l’envahir, ajoute-t-elle de manière pertinente, elle redevient la fille. Cette question se pose également avec ses filles dont elle dit former avec elles un tout : « Il y a le couple : les filles et moi, et mon mari à côté. Ça ne va pas » se rend-t-elle compte. Dans ce cas, la relation avec son mari en pâtit et celui-ci est convoqué à intervenir de manière abrupte auprès des filles. Il se plaint que Mme L. le contredise toujours en leur présence. Je souligne en effet qu’il leur faudrait des moments seuls pour parler et qu’elle peut le dire aux filles. Elle acquiesce : « il faut qu’il y ait mon couple d’un côté et les filles de l’autre, sinon j’angoisse ».
En résulte un effet thérapeutique : « J’étais le couple avec ma mère et mon père était un satellite. Je me rends compte maintenant, mon angoisse est de reproduire ça ». Mme L. a pris la décision de mettre à nouveau des distances raisonnables avec sa mère, et de mettre sa seconde fille à l’école avec à l’horizon la reprise du travail. Mme L. sait qu’elle doit penser à elle et l’angoisse est devenue le « signal d’alarme » qui lui fait dire qu’elle doit se « réajuster ». Il faut qu’elle arrive à penser à elle, et c’est ce qu’elle est en train de faire en créant une association d’entre-aide entre les habitants de son quartier. Ce cas illustre une clinique de l’Autre méchant. L’adresse au CPCT-parents doit permettre à ce sujet d’ouvrir une brèche vis-à-vis d’une sentence énoncée par l’Autre : « Il n’y aura pas de retour en arrière », et d’en saisir la valeur de jouissance, afin de poursuivre au-delà.