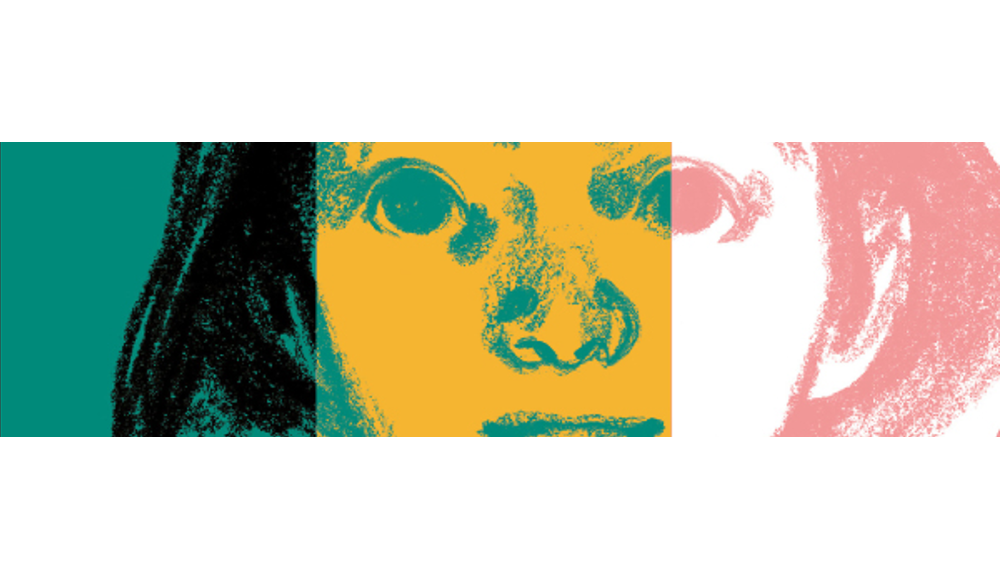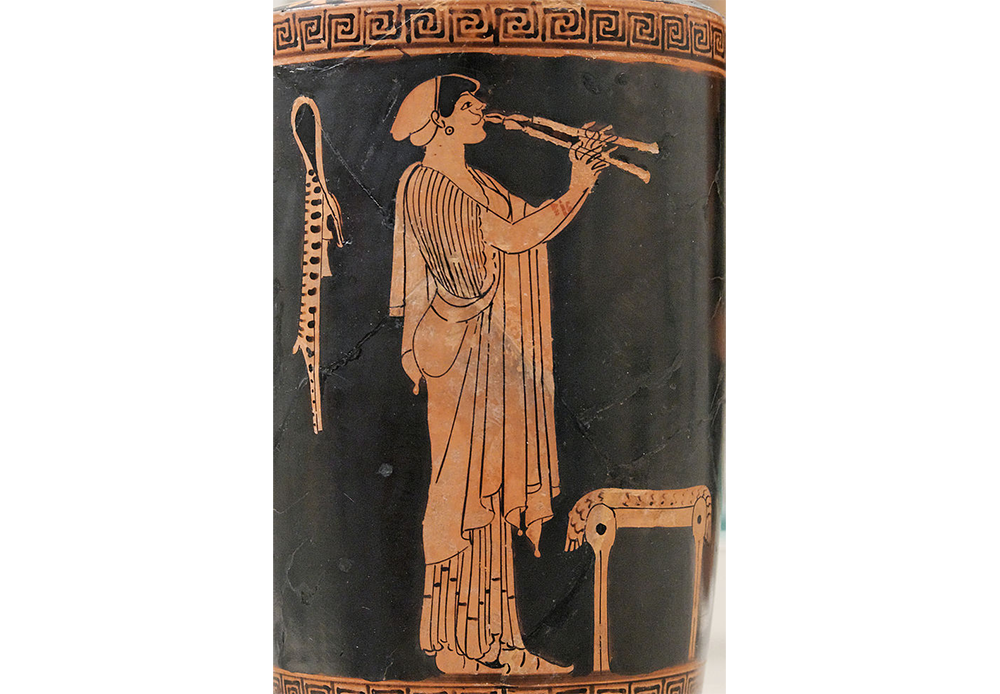Derrière le discours actuel sur l’addiction réduite à un comportement pathologique, existe-t-il un sujet du désir et donc la possibilité d’un lien à l’Autre ? Aurélie Charpentier-Libert aborde cette question en l’introduisant par ce qu’elle extrait d’une conférence de Pierre-Gilles Guéguen à Buenos Aires.
« C’est à cela que la psychanalyse peut travailler avec le sujet toxicomane : parier sur le fait que l’objet qui est choisi ne sature pas toute la jouissance et aider à supporter, grâce à la chaîne de la parole, le plus de jouissance possible en s’appuyant sur les inventions signifiantes qui entoureront le trou. »[1]
La jouissance autiste du sujet dit addict
Jacques-Alain Miller pose la question de la demande du toxicomane à l’endroit de la psychanalyse ; il précise : « la toxicomanie présente un symptôme sur lequel les effets de vérité de la parole peuvent paraître sans prise, un symptôme, donc, qui oblige à disjoindre les structures de fiction de la vérité et un réel qui insiste »[2]. L’objet en cause dans la toxicomanie nous confronte donc à un réel que rien n’entame, sur lequel la parole n’a pas de prise. Cet objet « concerne moins le sujet de la parole que le sujet de la jouissance, en tant qu’il permet d’obtenir, sans passer par l’Autre, une jouissance »[3]. Si le sujet dit addict ne demande rien, c’est que son partenaire unique est l’objet drogue. Il se passe ainsi de l’Autre et court-circuite de ce fait la question sur le sexuel. La dimension autistique du symptôme[4] se dénude dans cette jouissance du toxique.
Cependant, bien que l’Autre se situe en dehors de cette jouissance Une, il ne peut en être complètement disjoint, comme nous l’observons dans le cas de S.
La loi du silence
S., que je rencontre lors de l’un de ses séjours en psychiatrie, m’explique que son plus jeune fils est décédé d’un accident, il y a cinq ans. Même si elle établit ainsi un lien direct entre la mort de son enfant et le début de ses hospitalisations, ce lien en question n’est pas dialectisé et vient empêcher tout questionnement. Pour elle, il n’y a rien d’autre à dire. Sa parole se referme sur ce jour funeste. « J’ai rien à dire » est le leitmotiv de nos entretiens.
Le décès de sa mère, quelques mois plus tard, provoque un premier changement dans sa prise de parole : « Ça m’a fait un choc, comme la mort de mon fils ». Je la questionne sur les circonstances de cet accident. Elle parle alors d’un premier « choc », quelques jours avant le drame, en apprenant que son mari avait une seconde épouse et un enfant de celle-ci. À la suite de ces deux événements, son monde s’écroule.
Elle demande le divorce et renonce à la garde des enfants. Elle entre alors progressivement dans un isolement et une déchéance totale qui témoignent de son effondrement subjectif.
Ainsi, à la mort de sa mère, elle sort un peu de son silence et commence à reconstituer des bribes de son histoire. Un trait d’identification à cette dernière se dégage alors : « Je suis comme ma mère, elle parlait pas beaucoup ». Garder le silence constitue même le conseil maternel fondamental. Ce que sa mère taisait, c’était la violence du père envers elle et ses enfants. S. a dès lors intégré cette position de femme maltraitée silencieuse.
Le toxique : réponse à la jouissance de l’Autre
La prise de toxique sera sa solution ravageante pour ignorer l’Autre du langage au moment où le sentiment de vie vacille pour elle. En effet, la sédation par une lourde consommation de somnifères, prescrits au moment du décès de son fils, participe à la maintenir vissée à cette loi parentale : ne rien dire. Elle veut « oublier et dormir » et vit dans l’anesthésie de son corps et de sa parole pendant cinq ans.
Ce qu’elle livre durant nos entretiens reste d’une très grande précarité, mais elle accepte de confier à un autre ce qu’elle tente de taire depuis des années. Ainsi, elle se déleste en partie de son identification mortifère à sa mère et par là-même de son addiction. Le lien à la parole qui se crée la pousse à céder un peu sur sa jouissance.
S. m’explique alors qu’adolescente, ce qu’elle taisait étaient les abus du frère aîné sur elle, sans quoi son père « l’aurait tué » selon elle. Se taire est la position adoptée depuis pour sauver sa peau face à l’Autre sans borne du sexuel qui se jouit d’elle dans le Réel. C’est cette position que vient renforcer le somnifère quand sa vie familiale disparaît.
Une oscillation entre désir et jouissance
Les appuis que S. commence à trouver auprès de l’Autre entament sa jouissance. En réponse à mes questions concernant ses enfants, elle s’est à nouveau peu à peu intéressée à chacun et peut accueillir leur demande. Le lien avec eux s’est rapidement renoué.
La disjonction entre la parole et le Réel en jeu s’atténue. Cependant, la position de S. oscille toujours entre son désir de retrouver une situation sociale dont elle soit fière pour ses fils, et l’attrait vers la jouissance où l’Autre n’existe pas. Cela au-delà du toxique même, dont les prises se font désormais plus rares.
La jouissance par le toxique venait répondre à cette position identificatoire, se taire. Le silence de la pulsion, auquel elle ne parvient pas à renoncer totalement, trouve un nouvel aménagement.
[1] Guéguen P.-G., « Toujours un par un, et souvent un tout seul », Conférence au TYA, Buenos Aires, le 21 avril 2012, traduit de l’espagnol par Jose Alberto Altamirano Valladares pour le site addicta.org
[2] Miller J.- A., « Clôture », Le toxicomane et ses thérapeutes, Analytica, Paris, Navarin/Seuil, n°57, janvier 1989, p. 133.
[3] Ibid., p. 134.
[4] Miller J.- A., « La théorie du partenaire », Quarto, n°77, août 2002, p. 6-33.