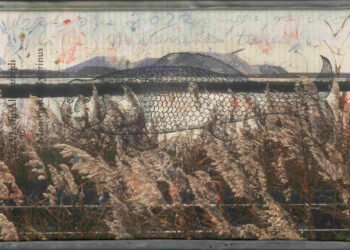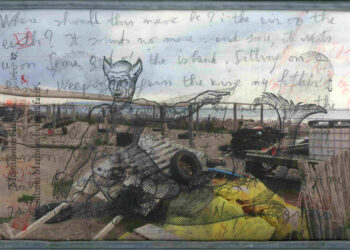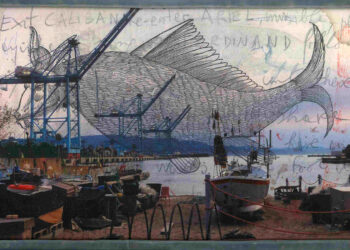Les Écrits paraissent en 1966. Un an plus tard, Lacan introduit son Séminaire L’Acte psychanalytique. Dans cet intervalle se produit une bascule dans son enseignement, avec l’émergence d’un statut nouveau de la vérité et le passage à une théorie de l’inconscient qui n’est plus celle, freudienne, de l’inconscient-non-savoir, ni même celle de l’inconscient-vérité. De façon contre-intuitive, il en vient à forger le concept d’inconscient-savoir.
Du pathos à la logique
À la fin de La Logique du fantasme, l’inconscient reste corrélé à la vérité : « Le discours analytique [sollicite] une vérité qui parle. [Il la sollicite], en somme, d’énoncer un ver-dict, un dict véritable1 ». Mais Lacan introduit déjà un premier coin en évoquant la logique aristotélicienne du tiers exclu. S’il continue, en juin 1967, de soutenir que le discours de l’inconscient se déploie dans le registre d’un dire-vrai, il tire en même temps la vérité vers la logique.
Là où il écrit, en 1955, que l’analyse progresse « essentiellement dans le non-savoir2 », soit dans le registre de la vérité, la promotion du savoir à laquelle il se livre à partir de la « Proposition du 9 octobre 1967 » entraîne une certaine dévalorisation de la vérité ; plus précisément, elle la « dépathétise3 ». Dans le Séminaire XV, Lacan va jusqu’à la qualifier de « connerie » – mis à part « les cas où nous pouvons aseptiser, ce qui revient à dire asexuer, la vérité, c’est-à-dire où, comme en logique, nous n’en faisons qu’une valeur, désignée par un grand V, et qui fonctionne en opposition à une autre, désignée par un grand F »4. L’insistance n’est donc « plus […] sur le parler mais sur l’écrire5 ». Nous sommes loin de « La science et la vérité », où la vérité au sens psychanalytique, la vérité prophétique dont la prosopopée repose sur un Je parle, est sans lien à l’exactitude. Non châtrée, marquée du sceau de l’horreur6, elle se déploie dans le registre de la passion.
Ce virage de l’inconscient de la vérité au savoir n’est pas le premier – que l’on songe à l’inconscient-langage ou à l’inconscient-discours de l’Autre – et, comme les précédents, il n’est « pas facilement soluble par un ordonnancement chronologique, selon lequel une formulation surclasserait l’autre7 ».
Déficience de la vérité
L’accent porté sur l’inconscient comme savoir conduit Lacan à s’interroger sur le savoir de l’analyste : « ce dont il s’agit, c’est de ce qu’il a à savoir8 ». Savoir inconscient et savoir de l’analyste ne sont pas à confondre, sauf à faire du savoir de l’analyste une accumulation d’interprétations aussi délirantes que celles dont a pu faire l’objet l’Alhambra de Grenade9 – ainsi de l’acte manqué consistant à tirer de sa poche les mauvaises clefs devant une porte, qui peut se voir interprété tout aussi bien comme J’aurais aimé être ici comme chez moi que comme J’aimerais mieux être chez moi10. Ce n’est pas non plus un savoir équivalent à la connaissance, soit le type de savoir dont on sait qu’on le sait11. C’est un savoir défini comme « quelque chose qui lie, dans une relation de raison, un signifiant S1 à un signifiant S212 ». Il est donc « indépendant de la condition du Je sais13 ».
Cette bascule résulte du dévoilement, au cours du Séminaire XIV, du « grand secret » de la psychanalyse : « il n’y a pas d’acte sexuel »14. L’inconscient est un savoir, parce que le sujet y cherche une réponse à la question « qu’est-ce que le rapport sexuel ? », mais ce qu’il y trouve, c’est une jouissance – et une répétition15. À cette question, la vérité ne peut répondre, car il y a une « déficience, énonce Lacan dans L’Acte psychanalytique, qu’[elle] éprouve de son approche du champ sexuel16 ». Cette déficience, c’est sa connerie.
Nathalie Jaudel
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La Logique du fantasme, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien éd., 2023, p. 409.
[2] Lacan J., « Variantes de la cure-type », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 361.
[3] Cf. Miller J.-A., « Le paradoxe d’un savoir sur la vérité », La Cause freudienne, n°76, décembre 2010, p. 127-128.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’Acte psychanalytique, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien éd., 2024, p. 47.
[5] Miller J.-A., « Vers un signifiant nouveau », Comment finissent les analyses. Paradoxes de la passe, Paris, Navarin, 2022, p. 92.
[6] Cf. Laurent É., « Le choc de l’(a) vérité et du fantasme opaque du psychanalyste », L’Hebdo-Blog, n°343, 1er juillet 2024, publication en ligne (www.hebdo-blog.fr).
[7] Miller J.-A., « Le paradoxe d’un savoir sur la vérité », op. cit., p. 122.
[8] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 249.
[9] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le banquet des analystes », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 29 novembre 1989, inédit. Voir aussi Miller J.-A., « Les conférences de Grenade : 2. Translations du savoir », 26 novembre 1989, disponible sur la chaîne YouTube Miller TV, notre traduction.
[10] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’Acte psychanalytique, op. cit., p. 46.
[11] Cf. Miller J.-A., « Les conférences de Grenade : 1. Une éthique sans surmoi », 24 novembre 1989, disponible sur la chaîne YouTube Miller TV.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 32.
[13] Miller J.-A., « Logiques du non-savoir en psychanalyse », La Cause freudienne, n°75, juin 2010, p. 185.
[14] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La Logique du fantasme, op. cit., p. 259.
[15] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le banquet des analystes », op. cit. Cf. aussi Miller J.-A., « Les conférences de Grenade : 2. Translations du savoir », op. cit.
[16] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’Acte psychanalytique, op. cit., p. 48.