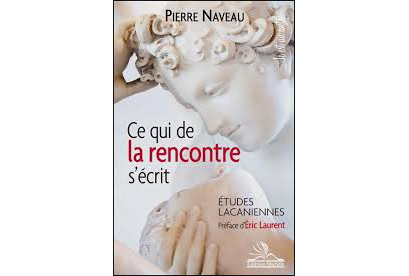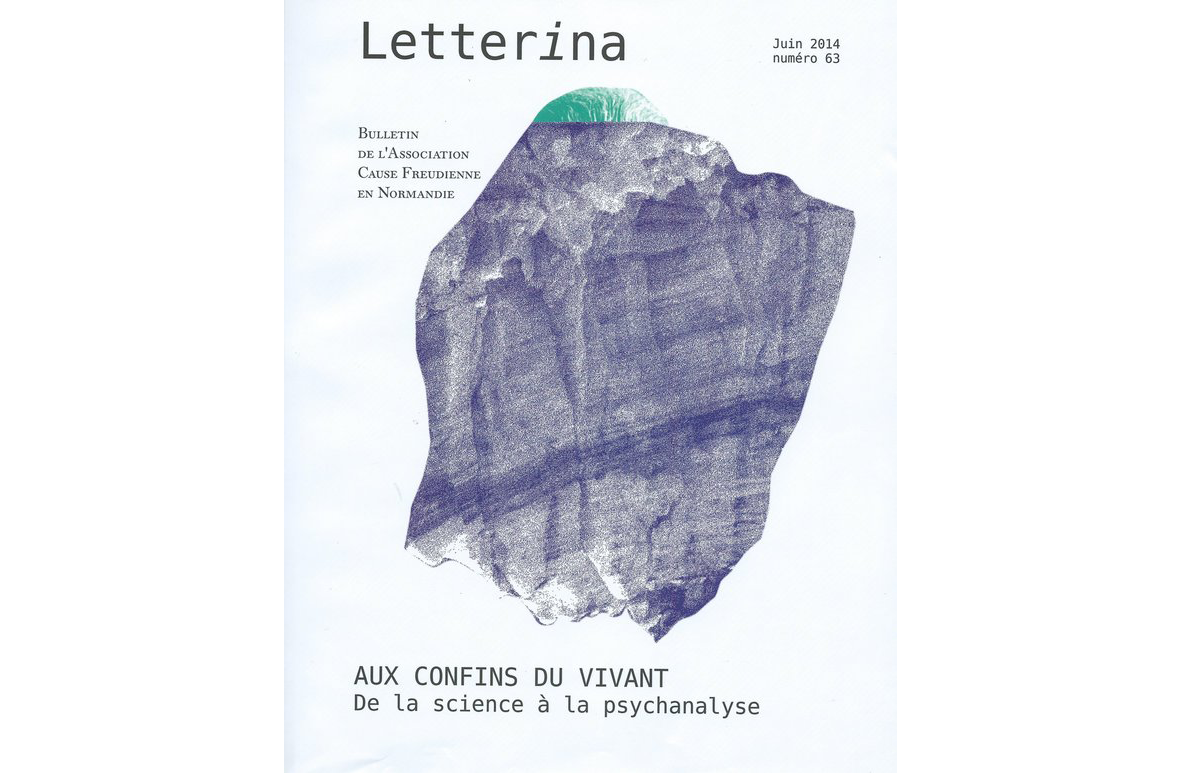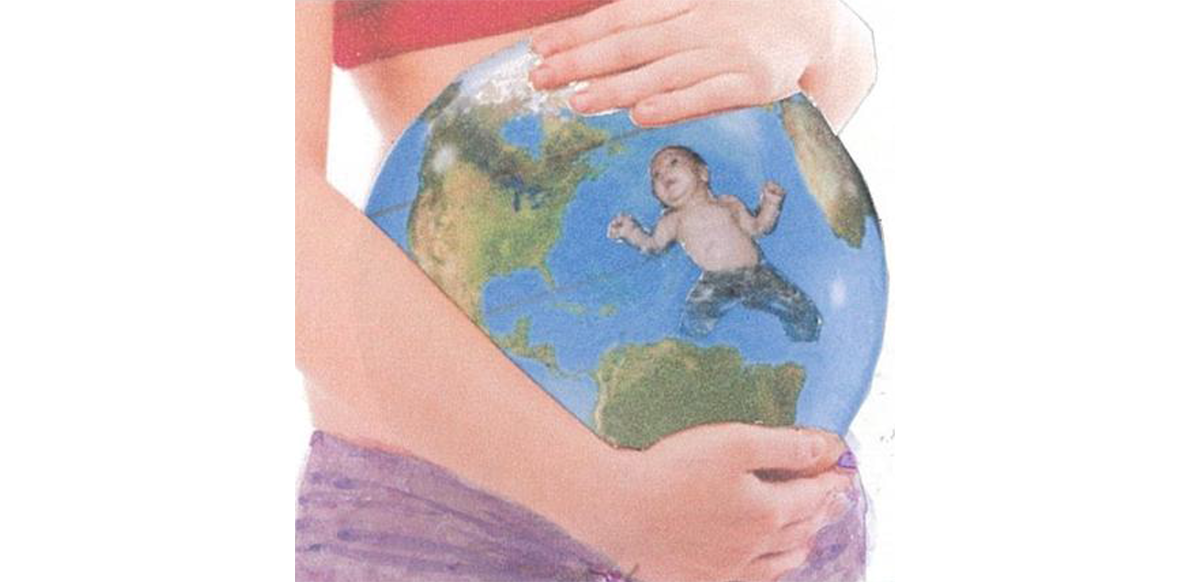Les médias nous en informent, l’amiante continue à faire des victimes. Si Aurélien Bomy nous livre ici le témoignage de sa rencontre avec l’une d’entre elles, ce n’est pas dans le registre de la victimisation qu’il nous présente ce sujet : à l’approche de la mort, c’est aussi dans sa position de père que ce dernier est touché. L’acte de l’analyste lui permet de s’en apercevoir, ainsi que de la répétition comme mode de transmission de père à fils.
« […] la Prägung – ce terme emporte avec lui des résonances de frappe, frappe d’une monnaie – la Prägung de l’événement traumatique originatif. […] Disons que la Prägung n’a pas été intégrée au système verbalisé du sujet, qu’elle n’est même pas montée à la verbalisation, et même pas, on peut le dire, à la signification »[1].
Prime à la mort
M. B. est atteint d’un cancer lié à l’amiante, reconnu maladie professionnelle. Suite à une indemnisation qui mobilise le signifiant Père, se pose la question de la transmission de cette « prime à la mort ». Sa femme désespère du débat conflictuel qu’il a avec elle et son fils concernant l’éducation des petits-enfants et du refus qu’il oppose aux traitements. Il juge préférable de ne vivre que quelques mois plutôt que de vivre plus longtemps mais diminué. C’est dans ce contexte de grande tension entre eux qu’elle l’emmène consulter.
La transmission de cette prime qui le tue littéralement, ne prend pas forme de dette. Il doit s’en débarrasser. Il veut que ses petits-enfants en bénéficient, mais qu’ils en fassent usage dans « la ligne » : une droiture féroce qu’il tient de son père militaire. Déçu par son fils, en conflit avec lui au sujet des petits-enfants et redoutant que sa femme ne fasse « passer ça avec des étrangers », il ne peut faire confiance en leur « mauvais jugement ».
Pardon et excuse
M. B. garde toujours raison. Je prends le parti de ne pas argumenter avec lui, mais plutôt de conforter ses positions et de m’intéresser à la précision des mots qu’il emploie. J’interroge par exemple la différence qu’il fait entre pardon et excuse. M. B. cherche « une clé, une formule » car il est toujours « le bouc émissaire ». Se décrivant « emmerdeur, plieur de cheveux en quatre, pour protéger la famille », M. B. est certain de son « jugement sain » et se sait aussi exigeant avec son entourage qu’avec lui-même. Il se plaint d’être encore obligé de « les » éduquer et envisage de faire placer sa femme sous tutelle. « Je ne peux pardonner ou excuser tant que le sujet n’est pas réglé ». S’il ne peut accepter le pardon qui implique un Autre en supériorité, l’excuse est plus tolérable, puisqu’elle peut s’adresser à l’autre sur un pied d’égalité.
La ligne
S’employant à une « transmission éducative de la ligne », M. B. est ralenti dans ce qu’il a à régler avant de mourir à cause des « mauvaises interprétations » qu’il rencontre. Il m’apporte les textes choisis pour la cérémonie. L’important est de « ne pas être oublié ».
Je lui demande s’il a connu l’oubli. Il s’effondre en larmes et parle de son placement, de quatre à sept ans, chez ses grands-parents, de son père qui « a fait » l’Algérie. Il révèle l’aveu que quelque chose le hante à propos de son père : « Les fois où je pourrais douter, il faut que ça se règle. Il est impossible qu’il ait fait des tortures. Faut pas que ça s’écarte de la ligne pour être en sécurité, pour que les choses ne glissent pas. Trouver la juste valeur des mots. Il y a des pensées qui sont présentes dans le monde, envahissantes : ‟Combien de temps il reste ?” Ça empêche les préparatifs ». Ainsi, la ligne se confond avec le père tourmenteur ; un réel perceptible est omniprésent dans les séances. À partir de ce moment, M. B. pleure un peu à chaque rencontre. Il se redresse aussitôt pour retrouver sa posture combattive. Les mots affectent son corps vivant produisant un relâchement de l’extrême tension dans laquelle il se trouve.
La frappe
M. B. veut enregistrer une séance pour prouver que je conforte ses positions. Je refuse de cautionner qu’il entre, à son initiative, dans une mise en doute de sa parole. Il s’est passé quelque chose qu’il essaie, agité et dans un flot de parole ininterrompu, de me restituer en détail, menant une véritable enquête sur « le geste premier » pour établir la seule vérité : la sienne. Il veut prouver l’injustifiable d’avoir été frappé dans le dos par sa femme, « comme un gamin ». Il a senti une douleur. « Quand on me tape, je rends toujours », dit-il. Ainsi il a frappé sa femme qui dément avoir porté un premier coup et « a allumé le feu » en appelant les enfants. « Vous êtes frappé », lui dis-je. Cette phrase l’arrête. Je fais l’hypothèse que la vérité qu’il cherche tient au fait qu’à ces moments-là, et de manière générale – par la maladie, des douleurs –, il est frappé par un insupportable qu’il veut éviter.
M. B. commence à témoigner. Enfant, s’il recevait des claques, il avait surtout affaire à la « dissuasion ».
La poursuite de l’enquête conduit à situer le conflit autour de sa volonté de donner de l’argent à un petit-fils pour faire un bon placement. L’indécision de ce dernier ralentit sa démarche. M. B. veut déshériter son fils. Cette radicalisation traduit une urgence : « Faire une transformation de ce qui est subi ».
Transformer le subi
M. B. offre à son frère un livre sur l’Algérie : « Je sais ce que c’est, la guerre ». J’acquiesce : s’il ne l’a pas faite et si son père n’en parlait pas, il l’a vécue en silence par ce qu’il a connu de lui, car quelque chose ne peut pas se dire.
Il se bat dès lors pour transmettre autre chose qu’une éducation qui inculque ; la seule qu’il ait connue par laquelle on ne peut que subir et se taire pour survivre. Il prend des libertés par rapport à la ligne et se bat pour la vie. Quelque chose s’apaise. Souvent essoufflé, il m’informe de l’évolution de sa maladie qui n’a « aucune incidence sur le moral ». Douloureux, il accepte la morphine.
Son fils est plus distant. Sans se voir pendant plusieurs mois, ils échangent des sms. Si les premiers sont presque insultants, le dernier est poétique et très touchant. Au bout de quelque temps, les contacts reprennent, et il participe à des achats pour ses petites-filles.
Il tente d’« arrondir les angles », de ne pas dire les choses « comme un réquisitoire », mais plutôt « du bout des lèvres. Toute vérité n’est pas bonne à dire. Voilà une bonne clé ! »
[1] Lacan. J., Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, Seuil, Paris, 1975, p. 214.