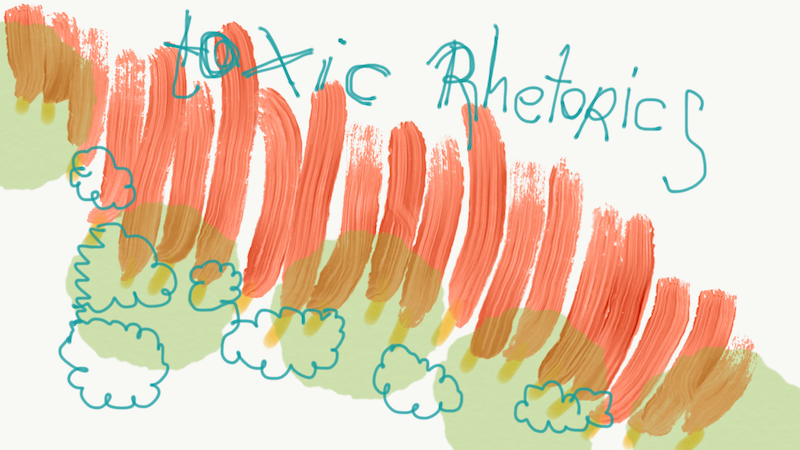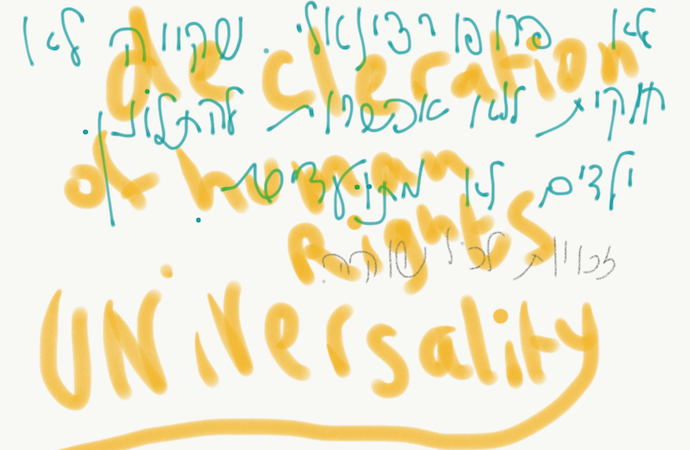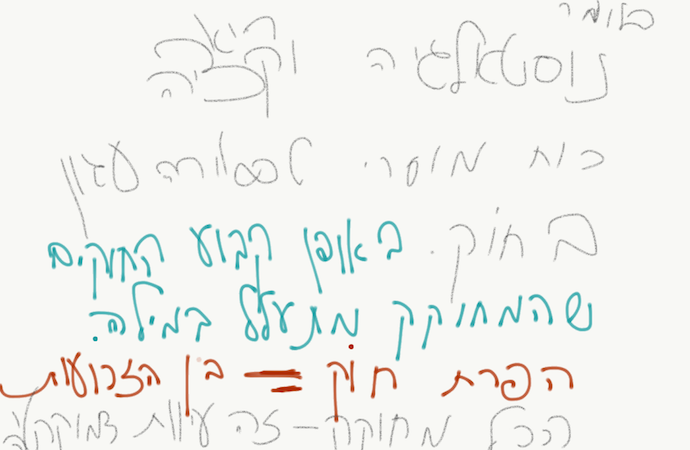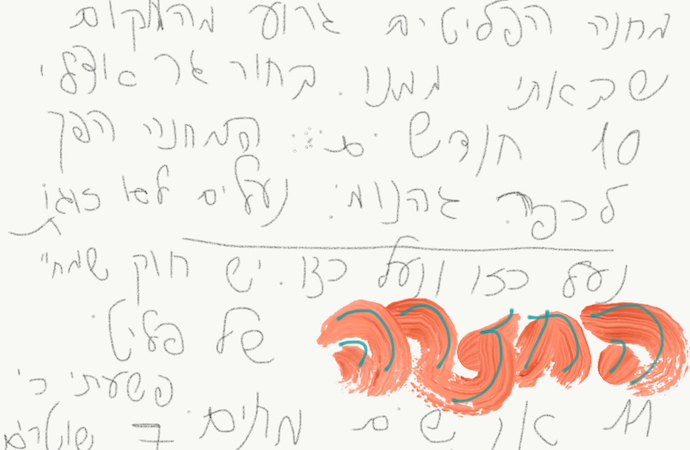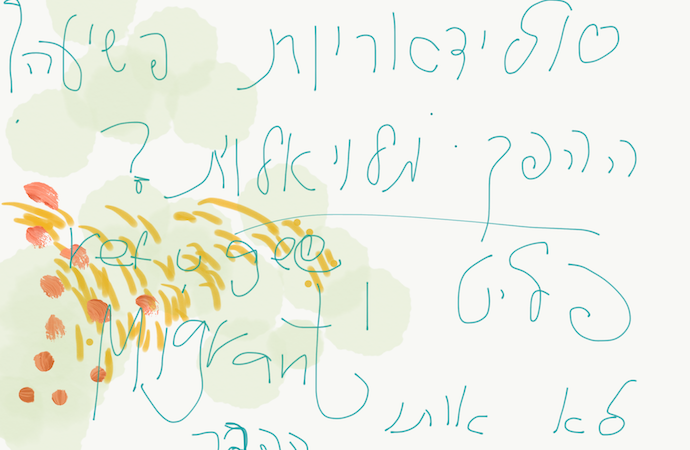Visuel : Sigalit Landau
Il se trouve que j’interviens en fin de journée [1]. Ce n’est pas pour clore la journée, c’est plutôt pour la prolonger, pour marquer des ponctuations, des résonnances. Comme les jeux de ce qui ne peut s’écrire comme frontières sur l’eau, contrairement au sable, que nous a fait voir Sigalit Landau. Ces jeux sur les frontières de l’eau nous parlent davantage que les tentatives d’élever des murs en méditerranée que Marine de Haas a fait valoir pour nous, ou les tentatives d’élever des frontières en mer d’Irlande comme le Backstop de Theresa May.
Il y a résonance, résonance entre discours. Ce mot a été promu par Lacan, mettant en valeur que, pour l’être parlant, il n’y a pas de formes de vie sans discours qui nous font vivre, qui nous guident, qui nous indiquent comment vivre. Ces discours nous font vivre, mais il y a aussi des discours qui nous font mourir, qui nous tuent. Dans les discours, il y a toutes les formes possibles de formuler le vœu de mort. Explicite, implicite, allusif… Tout ce que la rhétorique permet de dire et de ne pas dire entre les lignes. Toutes les ressources que Vincent Stuer a rappelées. Ou tous les glissements de sens des mots qu’ont mis en valeur Guillaume Le Blanc, ou Youri Lou Vertongen. L’argument du colloque s’appuyait sur les paradoxes de la rhétorique de certains discours qui tuent : « Leur caractère est insidieux, car ils n’ont rien de véhément. Les agents de ces discours qui tuent se présentent comme des grands serviteurs de l’État, voire même comme des héros modernes sacrifiant leur humanité pour faire leur devoir » disait Gil Caroz dans son argument. Ces agents peuvent être étatiques ou super-étatiques, comme on le voit spécialement dans les discours issus des instances de l’UE, s’exprimant au nom de valeurs communes, laissant au niveau des particularités nationales les intérêts passionnels. Gemma Calvet a fait entendre la dimension éthique qui réside au cœur du discours de l’Europe. Mais pourtant le fait de tenir un discours politique en s’appuyant sur ces valeurs élevées n’est pas sans présenter des paradoxes.
Les effets paradoxaux de l’Europe et son discours des valeurs
C’est ce qu’avait aperçu Jean-Claude Milner dans son livre de 2003 [2] sur Les Penchants criminels de l’Europe démocratique. Comme l’Europe laisse au niveau des nations les passions mauvaises nationalistes et la responsabilité des guerres, elle ne parle que de paix. Moyennant quoi, cette paix dont elle parle la met dans une grande difficulté pour comprendre le monde dans lequel il y a des guerres. On le voit en particulier dans la grande difficulté qu’elle a pour intervenir dans les labyrinthiques guerres du Moyen-Orient.
Milner avait fait valoir ce paradoxe mais aussi Hans Magnus Ezenberger qui, dans son beau livre Le doux monstre de Bruxelles (2011), présentait à la fois les énormes mérites de la bureaucratie bruxelloise, et les sources du rejet dont elle peut faire l’objet. Il citait avec beaucoup d’éloge les livres de l’écrivain autrichien Robert Menasse parlant de la réalisation d’une bureaucratie enfin à la hauteur de celle qu’avait réussi à construire Joseph II en Autriche en son temps [3].
Mais il y un mais, l’expansion de cette bonne bureaucratie, est aussi non démocratique. Car dans l’UE, la séparation des pouvoirs est abolie. Le Parlement est élu, mais il n’a pas l’initiative des lois. Cette prérogative est à l’initiative de la Commission. Or, la Commission est l’institution dans laquelle il n’y a pas de légitimation démocratique. La triade, Parlement-Conseil-Commission, avec toutes ses qualités, a néanmoins un aspect démocraticide. Là se situe l’originalité de ce pouvoir étrange qu’incarne le discours de l’UE comme tel et sa pédagogique insistance qui lui tient lieu de douce rhétorique démocratique.
Discours qui veulent explicitement tuer : USA
Par contre, la rhétorique américaine, que Vincent Stuer opposait très justement au manque de rhétorique européenne, peut être beaucoup plus brutale, sans aucune douceur. Il y a aux États-Unis des discours qui veulent tuer. Celui qui, le 28 octobre, a tiré dans la synagogue de Pittsburgh, en tuant onze personnes un jour de shabbat l’a fait en disant : « Tous les juifs doivent mourir ». Il l’a écrit sur les réseaux sociaux avant de passer à l’acte.
Moyennant quoi, Howard Fineman, de la chaîne NBC, en tire les leçons suivantes : « Sans diminuer la souffrance et la mort de qui que ce soit d’autre, il est triste de constater que face à l’effondrement des valeurs sociales et politiques, les Juifs jouent souvent le rôle des canaris dans la mine de charbon. » Et il poursuit et fait de ce passage à l’acte le « signe de la vision cynique et impitoyable du président Trump […] [qui] déchire une société déjà soumise au stress du changement générationnel, démographique, technologique, économique et social ».
Au fond, cette violence à ciel ouvert fait aux États-Unis que la haine, comme Jonathan A. Greenblatt, Président de l’Anti-Defamation League, l’a soutenu dans un article récent « devient mainstream » [4]. Le surgissement de la haine au premier plan, est aussi un point qu’un professeur de neurosciences, Richard A. Friedman, a repris. Dans un article intéressant de neurosciences appliquées « Lorsque que quelqu’un, dit-il, comme le Président Trump déshumanise ses adversaires, il les situe au-delà de l’atteinte de l’empathie, leur enlève leur protection morale et rend plus facile de leur faire du mal. Si vous avez des doutes sur le pouvoir de la parole politique de fomenter la violence, alors rappelez-vous l’expérience classique du psychologue de Yale Stanley Milgram, qui au début des années soixante étudia la disposition d’un groupe d’hommes à obéir à une figure d’autorité. […] [Il montrait] combien facilement on peut être poussé à faire des choses terribles simplement en obéissant aux ordres » [5]. C’est là où « words can break the bones », selon le proverbe que Gianfranco Pasquino nous rappelait.
La dénonciation de la haine peut devenir mainstream de bien des façons, dans les discours politiques américains. Mais une des particularités de la rhétorique américaine est le miroir entre d’un côté le discours politique ou discours du maître, qui se tient sur la place publique, et de l’autre le discours universitaire qui se tient sur les campus et qui se veut ; parfaitement, ou le mieux possible, expurgé des discours qui tuent ou excluent. En Europe aussi nous avons cette opposition, entre les discours qui sont dans la rue et les discours qui sont dans l’université. Comme ici, dans ce Forum, personne parmi ses participants ne serait partisan des discours qui tuent. Ils sont dehors. Mais là encore, cette opération ça n’est pas sans restes.
Les paradoxes du discours universitaire
L’université s’est acharnée à tenir un discours vidé de ces passions haineuses et pourtant les étudiants ne se sentent pas pour autant liés les uns aux autres par l’amour comme l’aurait voulu Simone Weil, invoquée dans notre Forum. Le politiquement correct s’est efforcé de régner, plus sincèrement certainement que le discours de Kurz cité par le Pr Wolfgang Petritsch. Pourtant le sentiment de solitude des étudiants n’a jamais été aussi grand. La génération postmillennials, née après 1995, la génération « Gen-Z », a développé davantage d’angoisse et une plus grande hypersensibilité. Les taux de suicide ont augmenté de manière spectaculaire dans les universités américaines depuis les années 2011-2012 (+25% chez les garçons et +70% chez les filles) [6]. C’est pour ça que la tâche du politiquement correct est sans fin. Après avoir tenté de toucher au niveau des grandes catégories des discours qui tuent ou excluent, on essaie d’aller plus loin pour déminer les pouvoirs délétères des discours.
Récemment, un mot a fait son apparition sur les campus américains : « la microagression ». Le professeur Derald Wing Sue, de l’université Columbia, à New York, a publié en 2010, Microaggressions in Everyday Life. Race, Gender, and Sexual Orientation. Le chercheur définit ainsi les microagressions : des insultes ou attitudes « intentionnelles ou non » qui « communiquent des messages hostiles ou méprisants ciblant des personnes sur la seule base de leur appartenance à un groupe marginalisé ». L’extension du champ des microagressions, qui semble fondée pour certains, et porteuse d’espoir, est pour d’autres plutôt génératrice d’excès et va en rajouter en termes de ségrégation entre communautés [7].
Les partisans des deux positions s’affrontent. On retrouve là une question qui fait débat au sein des politologues américains, et qui aussi intéresse l’Europe. Il s’agit de la politique des identités, et de l’opposition qu’elle peut engendrer entre communautés de discours une par une, avec la question d’un bien commun ou d’un universel qui s’évanouit.
Les communautés de discours et le bien commun
On le sait, la campagne d’Hillary Clinton avait été tout entière fondée sur le ciblage de différentes minorités (Black ou Latinos), les femmes, et les minorités sexuelles, précisant à chacun les droits supplémentaires qu’elle ajouterait si elle était élue. C’était une politique des identités. Son slogan de campagne « Stronger together » mettait en exergue cette juxtaposition identitaire. L’addition des forces. De son côté, Bernie Sanders centrait sa campagne sur un point commun : les inégalités économiques, les méfaits des banques expropriant à tour de bras depuis la crise des subprimes, et les méfaits de Wall Street. Il reprenait la mouvance Occupy Wall Street, reprochant à Hillary sa trop grande propension à faire des conférences pour ces mêmes banquiers.
Au lendemain des élections présidentielles, un article du politologue Mark Lilla de l’université de Columbia, a considéré que l’échec de Mme Clinton était celui d’une orientation politique fondée sur une politique des identités, qu’il fallait y renoncer, qu’il fallait passer à autre chose et qu’il fallait définir un bien commun pour l’Amérique comme telle, dans lequel puisse se reconnaître l’ensemble des démocrates Américains [8]. Au fond, il reprochait à cette politique des identités d’être dispersive.
Face à cette menace de dispersion, là où Lilla ne voit qu’une impasse, Judith Butler, voit au contraire une issue. Dans son dernier livre [9], traduit en français par le titre Rassemblement, mais qui en anglais s’appelle Towards the Performative Theory of Assembly, elle poursuit sa théorie dite « performative » de la sexuation et elle le fait au niveau des groupes. Elle situe la nécessité des rassemblements communautaires ou communautaristes définis à partir du fait qu’ils ne peuvent pas être reconnus par le discours commun. Cette impossibilité de représentation les définit et définit du même coup la possibilité d’un lien social fait à partir des exclus de la représentation. Elle souligne la force des mouvements de type Occupy. « Être là, se tenir debout, respirer, se déplacer, rester immobile, parler, se taire sont autant d’aspects d’un rassemblement soudain, d’une forme imprévue de performativité politique. Il importe que les places publiques débordent de monde, que des gens viennent y manger, y chanter, y dormir, et qu’ils refusent de céder cet espace… je serai transformé par les connexions avec les autres. » [10] C’est le contraire du rassemblement opéré par la banque centrale de la haine qu’incarne le populisme trumpien. Un rassemblement de l’amour qui pourrait se passer de toute référence à un universel partagé. Elle résout le problème du passage entre les identités vulnérables et les revendications de droits politiques en superposant ces deux niveaux par le rassemblement performatif étendu. L’articulation de ces niveaux est cruciale pour savoir si en effet pour nous protéger des discours qui tuent, les droits auxquels nous pouvons faire appel sont les droits des citoyens ou les droits de l’Homme ?
Contre les discours qui tuent. Droits des citoyens, Droits de l’homme
Notre époque est non seulement celle des discours qui tuent mais aussi celle de guerres de fait, de guerres sans déclarations, de guerres entre états dysfonctionnels, ou faillis, d’autres guerres menées par des hyperpuissances blessées, ou des guerres de religion, toutes guerres qui envoient sur les routes de l’exil des migrants par millions. Les droits des migrants passent au premier rang des préoccupations de nos démocraties et ces droits vont contre ces discours qui tuent et les conséquences des guerres. Mais comment situer le niveau d’articulation entre, précisément les droits de ceux qui ont quitté leur pays et n’ont pas de nouvelles citoyennetés ? Certains comme Giorgio Agamben en font la preuve de la fin de la démocratie parlementaire libérale remplacée par l’état d’exception permanent déclarant privé de droits celui qui n’est plus citoyen de nulle part. Il y voit l’actualisation de la figure du banni en Droit Romain, de l’homo sacer [11]. Et il doute de la puissance des droits de l’homme pour accueillir le sacer, celui qui sépare. Au contraire, J.-C. Milner montre que c’est cette question du migrant, de celui qui n’est plus citoyen, qui renouvelle la lecture des droits de l’homme et du citoyen. Il considère, à l’opposé de la critique marxiste qui dénonçait les droits de l’Homme comme le pur semblant bourgeois, que ces droits sont parfaitement incarnés et ont à être incarnés comme les droits de l’être parlant saisi par sa qualité d’être parlant [12]. Et il rapproche ces droits de l’Homme des droits du corps de l’être parlant de ce qu’a promu dans son dernier enseignement Lacan sous le nom du parlêtre qui a un corps. Il dit : « L’homme de la Déclaration annonce l’homme/femme du freudisme : à la différence de l’homme des religions et des philosophies, il n’est ni créé [celui des religions] ni déduit [celui des philosophies], il est né ; en cela consiste son réel. » [13] Il constate : « Face aux campements de réfugiés, le langage marxiste est frivole. Les droits commenceraient donc avec les excréments et les sécrétions ? … Quand bien même on a retiré aux individus leurs mérites et démérites, leurs actions innocentes ou coupables, leurs œuvres en un mot, ce qui reste a des droits. Guenille, ordure, tombeau, la plupart des religions, des philosophies et des héroïsmes méprisent cette part maudite » [14].
En effet, cette considération du migrant qui se retrouve pris dans ces camps, dont le dispositif d’accueil qui peut devenir, comme l’a souligné Guillaume Le Blanc, si vite carcéral, rejoint l’accent que Lacan mettait sur sa distance à l’égard de la croyance à l’histoire. À la fin de son séminaire sur Joyce, il note ceci : « Joyce se refuse à ce qu’il se passe quelque chose dans ce que l’histoire des historiens est censée prendre pour objet. Il a raison, l’histoire n’étant rien de plus qu’une fuite, dont ne se racontent que des exodes. […] Ne participent à l’histoire que les déportés : puisque l’homme a un corps, c’est par le corps qu’on l’a. Envers de l’habeas corpus. » [15]
C’est en effet l’enjeu que nous posent les migrants, cette condition qui est la nôtre de plonger dans une histoire qui est fuite. Même s’il ne s’agit que de 3% de la population mondiale, comme le notait François Herrand cité par Martin Deleixhe ce matin, c’est toute l’importance qui se joue dans le pacte pour les migrations des Nations Unies, qui a été concocté entre quelques 190 pays et finalisé le 13 juillet 2018, et qui doit être approuvé formellement à Marrakech le 10 décembre. Un à un, les gouvernements d’Europe centrale ont dit leur position, qu’ils ne voteraient pas, ils sont suivis par d’autres pays européens comme l’Italie et bien sûr par les États-Unis. Pourtant, ce pacte sera sans doute signé par un nombre assez important de pays. Les Nations Unies préparent, après le pacte sur les migrants, un pacte sur l’asile et le droit d’asile comme tel.
Les populismes d’aujourd’hui et ceux des années trente
L’opposition des discours des populistes face à toute norme sur l’accueil des migrants est fondamentale. Au-delà de ce point, il faudrait situer la différence entre le populisme contemporain et les populismes des années trente sur la désignation d’un bouc émissaire. Un politologue, Raphaël Liogier, a récemment proposé : « Le populisme actuel est foncièrement original, empreint d’angoisse collective face à la globalisation (que ce soit sous la forme de l’‘‘immigration rampante’’, du ‘‘capitalisme sans frontière’’, de ‘‘l’islamisation du monde’’), et surtout postidéologique. Contrairement aux années 1930, où il se nourrissait de solides doctrines marxistes ou racialistes, le populisme d’aujourd’hui, héritier de la perte de crédibilité des grandes idéologies qui ont marqué le XXe siècle, est en effet opiniologique. » [16] En ce sens, l’invention d’Orban par la démonisation personnelle de Soros, telle que l’a montrée Kinga Goncz s’inscrit dans la série. Si l’on manque d’arguments anti-migrants, en Hongrie où ils sont si peu nombreux, alors Soros peut être désigné comme cause de tout le mal. Cette invention nominative fait partie de la liste des objets variables des populismes idéologiques. Liogier en conclut : « C’est en cela que l’on peut le qualifier de populisme liquide : il se révèle fluctuant dans le fond (le contenu doctrinal, ses logiques d’exclusion peuvent changer d’objet, allant du musulman au Rom, en passant par le Juif, le journaliste, l’immigré et l’homosexuel, selon les combinaisons les plus volatiles), et dans la forme (les opinions cosmopolites, les angoisses collectives, les frustrations circulent désormais via Internet à l’échelle de la planète sans contrôle idéologique clair, créant un effet d’immédiateté). » [17] J’ajouterais cependant que nous ne pouvons pas nous réjouir si vite de cette différence. Le populisme liquide, celui du liquide contemporain, peut changer d’ennemis tous les jours, il n’en est pas moins producteur d’un effet de l’un. Il produit ce qu’un autre politologue a appelé une « banque centrale de la haine » [18]. En effet, il peut changer mais il s’agrège. On obtient certes différemment le nationalisme tribal, l’effort de régénérescence d’une société prétendue décadente, dont parlait le fascisme des années trente se regroupant autour d’un chef et d’une doctrine solide. Pas de sens du sacrifice certes dans le populisme trumpien, mais un appel à une jouissance sans limite de jouir de la multiplicité des ennemis à abattre, de ceux qui ne jouissent pas comme moi.
Le besoin de rhétorique et les fake news
Nous avons besoin d’une rhétorique pour faire face à ces effets, à cette rhétorique de la haine comme Vincent Stuer l’a fait remarquer, et aussi pour faire face aux fake news que Michael Dougan a si bien fait valoir. Certes, la prolifération de ces fausses nouvelles est favorisée par le déclin des idéologies qui nous étaient communes, des grands récits, comme disait Lyotard, ou de ce qui faisait bien commun, sous la forme d’un idéal. Mais pour autant, l’absence de grands récits communs a une autre conséquence que la fragmentation. C’est que tous les récits communs sont maintenant remplacés par une seule exigence, celle d’être scientifique, celle de régner par la preuve, par l’evidence based. Et en effet, il y a quelque chose de puissant dans la déségrégation de la science. La science nous libère de nos particularités. Comme le dit Jacques-Alain Miller : « Si la science est déségrégative dans ses conséquences techniques, c’est parce que son discours exploite un mode très pur du sujet, un mode universalisé du sujet. Le discours de la science est fait pour et par tout un chacun qui pense Je pense, donc je suis. Ce discours annule les particularités subjectives, qui crient et se rebellent » [19].
Donc, premier temps, libération, déségrégation, construction d’un espace de raison commun. Puis deuxième temps, insurrection des jouissances, le calcul accentue ce qui résiste à son inclusion, il provoque l’insurrection de ceux qui se refusent à TINA, à There Is No Alternative. Si la raison dit qu’il n’y pas d’autre alternative, alors je renverse la table de la raison. La globalisation produit la révolte des laissés pour compte du marché universel qui est un pur calcul. C’est aussi bien en Europe à l’intérieur d’États complexes la résistance des nations particulières comme l’Irlande, la Catalogne, l’Écosse. C’est aussi l’histoire européenne qui revient comme un boomerang pour séparer les divers peuples issus de la colonisation qui se retrouvent plongés dans les marchés communs. En Amérique, ce sont les peuples indigènes, qui de la Terre de feu à l’Alaska, revendiquent la reconnaissance d’une culture et de droits qui ne peuvent se résorber dans l’universel. Au fond, partout, les jouissances particulières se refusent à s’uniformiser. Alors bien sûr la science et son discours tentent de recréer une sorte de sagesse où tout pourrait s’agréger, comme par exemple les néo-sagesses des fêtes californiennes de type Burning Man. Où la contemporanéité se propose de donner en spectacle le traitement de toutes les jouissances dans une parade de la fierté technologique. Mais il semble bien que les jouissances restent séparées, y compris dans les diverses sectes qui veulent les regrouper ou les juxtaposer dans un Autre de synthèse New Age.
Le populisme des années trente et le multiple de la jouissance d’aujourd’hui
Le multiple du populisme contemporain fait converger les multiples colères ou rages sur un même leader qui se retrouve dans la position de jouissance sans limites, cet objet homogénéisant les jouissances que Freud avait isolé dans sa Massenpsychologie, un phallus réel dit Lacan. Les réseaux sans leader, comme les Gilets jaunes en France, quelle que soit leur hétérogénéité, ont aussi besoin d’un objet unifiant. C’est alors le bouc-émissaire qu’ils mettent en commun : Emmanuel Macron.
Mais il y a aussi dans nos populismes et dans nos civilisations, un principe de déshomogénéisation qui est à l’œuvre, celui qui s’entend dans le lien qui s’est établi entre les droits des femmes et les droits des minorités sexuelles. Elles produisent un effet déségrégatif qui déplace la situation des années trente. Le surgissement des femmes dans l’élection américaine est frappant. Les ruses de l’histoire sont grandes ; on attendait la première femme président, par le top, on a eu Trump. Mais par contre, au midterms, deux ans après, c’est par le bas, c’est bottom up, que surgit une redéfinition de la place des femmes dans la politique démocratique.
L’écart entre hommes et femmes n’a jamais été aussi grand dans la politique américaine que dans ces élections de midterm. « Jamais l’écart entre le vote féminin et le vote masculin n’a été aussi grand : plus de vingt points ; 60% des femmes ayant fait des études universitaires ont voté pour un candidat démocrate, d’après les sondages de sortie des urnes. Les taux de participation des femmes, des jeunes de moins de trente ans, des membres de minorités ethniques, ont été particulièrement élevés dans ces élections très particulières qui, d’habitude, ne mobilisent qu’un tiers des électeurs, contre 49% cette année. » [20]
Du côté des électeurs, il y a un effet déségrégatif, et aussi du côté des élu·e·s. La nouvelle vague des élues américaines est pour beaucoup passée par l’armée, où les femmes sont admises depuis vingt ans. Pour les élus, féminins ou masculins, l’état de service aux armées est crucial. Ou bien il faut avoir été travailleuse sociale. Comme par exemple Kyrsten Sinema (Démocrate, Arizona). « Âgée de 42 ans, la nouvelle sénatrice – qui avait été la première élue du Congrès ouvertement bisexuelle ». Et elle fait de sa bisexualité un argument pour expliquer qu’elle pourra très bien travailler et avec les Démocrates, et avec les Républicains.
Il y a aussi Deb Haaland (Démocrate, Nouveau-Mexique). Indienne, fille de militaire, puisque beaucoup d’Indiens ont été enrôlés dans les troupes américaines. Elle a elle-même soutenu le coming-out de sa fille qui milite ouvertement pour les droits LGBT aux États-Unis et elle a été élue dans cet État, le Nouveau Mexique, qui n’est pas réputé pour être aussi libéral que les États de la côte Est. Il y en a d’autres qui produisent cet effet déségrégatif, étrange, comme Ilhan Omar (Démocrate, Minnesota), qui, musulmane, a réussi à se faire élire sur un programme assez proche de Sanders. Les effets déségrégatifs sont là. C’est ce qui change par rapport au discours populiste des années 30. J’en prendrais aussi l’exemple avec ce fait de samedi dernier, les gilets jaunes en France manifestaient en même temps que le mouvement #metoo français. Y aura-t-il les gilets d’un côté et les communautés féministes et LGBT de l’autre, irréductibles l’un à l’autre ? Il ne me semble pas. Il y aura des intersections entre les discours communautaires et ces discours instables fragiles, ce discours qui se tue lui-même qui s’auto-détruit, comme ce discours des gilets jaunes se voulant absolument a-représentatif. Le représentant des gilets jaunes reçu par le Premier ministre français souhaitait que l’entretien soit filmé et public. C’était semble t-il pour se protéger. Il expliquait à la presse en sortant que si les « représentants » du mouvement sont venus si peu nombreux, c’est qu’ils avaient reçus des menaces de mort. « 90% des menaces venaient d’autres gilets jaunes », ajoutait-il. Voilà une déclaration bien de l’époque : un chiffrage précis, les réseaux sociaux, le discours qui veut tuer. Comptons plutôt sur l’effet civilisateur du discours féministe pour obtenir un effet déségrégatif et vivre le plus possible sans Gremlins comme le souhaitait Guillaume Leblanc, qui mettait tant l’accent sur le principe d’hospitalité. Les forums européens, comme celui-ci, sont l’occasion de poursuivre les échanges entre le discours psychanalytique et les autres discours, dans la mesure où nous considérons qu’il y a un obstacle au principe d’hospitalité généralisé. Il y a le Gremlin de notre propre jouissance à laquelle nous n’arrivons pas à donner hospitalité. C’est un reste inéliminable, qui fait le moteur de l’expérience psychanalytique et des symptômes qui ne cessent de se produire. Ils nous provoquent sans cesse à articuler de bonnes réponses, au-delà de la nécessaire rhétorique que nous avons, avec d’autres, à élaborer.
[1] Intervention au Forum européen Zadig en Belgique, Les discours qui tuent, qui s’est tenu le 1er décembre 2018 à Bruxelles.
[2] Milner J.-C., Les penchants criminels de l’Europe démocratique, Lagrasse, Verdier, 2003.
[3] Enzensberger H. M., Le doux monstre de Bruxelles ou L’Europe sous tutelle, Paris, Gallimard, 2011.
[4] Greenblatt J. A., « When hate becomes mainstream », The New York Times, 28 octobre 2018, disponible sur internet.
[5] Friedman R. A., « The neuroscience of hate speech », The New York Times, 31 octobre 2018, disponible sur internet.
[6] Lesnes C., « Illégitime défense », Le Monde, 1er décembre 2018.
[7] Ibid.
[8] Lilla M., « La gauche doit dépasser l’idéologie de la diversité », Le Monde, 8 décembre 2016, disponible sur internet.
[9] Butler J., Rassemblement, Paris, Fayard, 2016.
[10] Cité par Eric Aeschimann in « Comment vivre dans ce monde ? », L’Obs., 8 décembre 2016.
[11] Agamben G., Homo sacer, Paris, Seuil, 2003.
[12] Milner J.-C., Les penchants criminels de l’Europe démocratique, op. cit.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Lacan J., « Joyce le Symptôme » (1979), Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 568.
[16] Liogier R., « Populisme liquide dans les démocraties occidentales », in Badie B. et Vidal D. (s/dir.), Le Retour des populismes, L’état du monde 2019, Paris, La Découverte, 2018, p. 40.
[17] Ibid.
[18] Expression de C. Salmon.
[19] Miller J.-A., « Les causes obscures du racisme », Mental, n°38, novembre 2018, p. 145.
[20] Lacorne D., « Midterms : ‘‘Les femmes ont exprimé leur ras-le-bol de l’esprit haineux de Donald Trump’’ », Le Monde, 8 novembre 2018, disponible sur internet.